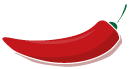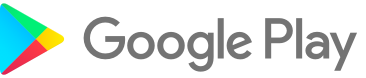La nostalgie n’est pas forcément une bonne chose dans la mesure où l’histoire ne repasse jamais les plats ; mais comment y échapper ? A défaut de cultiver la nostalgie, laquelle est source d’amertume et d’ulcères, entretenons au moins le souvenir de ces femmes et hommes, voire de ces gamins qui nous ont marqués à jamais au plus profond de nous-mêmes.
« Diak-wo-hue ! »
A la toute première place, un de ces personnages qui ont longtemps « hanté » nos routes et suscité notre admiration, à une époque où le cachalot restait à inventer, était le charretier avec sa charrette-boeuf. C’était le temps où ces engins avec leurs grandes roues cerclées de fer mettaient un temps fou à arriver à la « balance ». Il y en avait alors des centaines autour de l’île. La vraie « Balance-Coco », celle où officiait mon papa, était à la sortie Nord de Saint-Louis ; les jours sans école, mon père m’y emmenait. On voyait arriver les musclés boeufs-moka, un peu transpirants. Le conducteur de l’engin prenait le temps de souffler : il avait passé la nuit à couper et charger ses cannes.
Ils étaient tous armés d’un redoutable chabouk, arme terrible qui servait plus à diriger l’attelage qu’à vraiment frapper : les bêtes avaient l’habitude de réagir aux claquements du fouet « au-dessus » de leurs cornes et à des onomatopées ou des claquements de langues, « diak-wo-hue » pour avancer, « glllll » pour reculer, « tèk-tèk-tèk » pour arrêter… « L’ariage », le frein à vis filetée, coinçait la roue dans un grand bruit de ferraille martyrisée. Le boeuf-moka cessait aussitôt d’avancer, pas fâché lui non plus de souffler un peu.
Cette race était, je crois, issu d’un métissage entre le zébu malgache et leurs potes venus d’Ethiopie, d’où cette incroyable robustesse et cette vertu à se contenter de peu. Vivre en savane sèche ne les dérangeait guère. Ils ne manifestaient de signes de fatigue que lorsque vraiment la pente était trop prononcée ; d’où l’expression « li transpir’ comm’ in bèf dans la Pente-Nicole ».
La seule fois où j’ai personnellement vu un charretier taper du fouet, ce fut à Saint-Joseph. J’étais un moutard de 8 ans et, sur le mur de mon Pépé Justinien, je l’écoutais m’enseigner quelque fable de La Fontaine. Nous entendîmes arriver la charrette : ces grandes roues cerclées de fer faisaient un boucan superbe sur les chemins macadamisés comme la quasi-totalité des routes de la Colonie alors.
Outre le vacarme des roues, il y avait les cris, disons les hurlements du charretier et les claquements de chabouk. L’attelage passa en-dessous du mur où nous nous tenions. L’homme tapait « tant qu’ n’avé d’la force et d’courage » sur le cuir du boeuf. La moustache de Pépé se hérissa… Ça sentait l’orage. Le bonhomme commit l’erreur de trop : il enfonça le manche du chabouk dans la narine du moka. Oh ! La! La !
« Tout’ son n’amour la fane dan’ chemin ! »
Pépé sauta du mur, fit deux pas en direction du charretier si mal embouché, lui arracha son fouet des mains et te lui administra une de ces tannées qui comptent dans la vie d’un homme. Le mec pleura, demanda pardon, promettant de ne plus recommencer.
Une précision s’impose ici… Lorsque je racontai cette histoire dans « Nouvelles à La Réunion » (éditions ADER), je fus insulté et fus « invité » à m’expliquer devant des étudiants en Lettres modernes. Question : « Pourquoi, monsieur Bénard, avez-vous ainsi stigmatisé l’attitude des Noirs ? » Ma réponse fusa : « Mademoiselle, dites-moi à quelle ligne j’ai parlé d’un charretier noir ? » Et pour cause : le charretier en question était un bon Yab des Bas-de-Jean-Petit.
Le mot « racisme » est de ceux que j’ai rayés de mon Larousse personnel depuis un sacré bail car je n’en ai jamais compris la signification ni le motif.
La charrette-boeuf ne servait pas que dans la coup’ cann’. Elle conduisait des familles entières à l’Office dominical. Aux baptêmes, aux mariages, aux communions. Lorsque la petite bonne de Mémé Anéa revint de la semaine de congé accordée à l’occasion de son mariage, Mémé, vieille malicieuse, lui demanda si cela avait été une belle fête.
« Ben… vis vois, mâââme Vitry, après la messe mariage l’église Saint Joseph, nous la remonte les Lianes dans la charrette mon beau-père. Mon mari té si tant serré cont’ mwin… ben toute son l’amour la fane dan’ chemin ».
La charrette-boeuf a été de tous les instants de notre vie sociale. Lorsque mamie Francia, à l’âge de 10 ans, habitait au Guillaume, elle allait à l’église de Saint-Paul en charrette. Lorsque la famille Maunier, du Bois-de-Nèfles Saint-Paul, allait à la messe dominicale au Port, ou encore en promenade, c’était en charrette. Lorsqu’une famille de Saint-André déménageait, c’était en charrette.
« Ala bazaaaar, madame, bazaaaar ! »
Ces grandes roues en bois cerclées de fer furent interdites lorsque routes et chemins furent bitumés : elles les abîmaient très vite. On les remplaça par des roues de voitures.
Cette interdiction entraîna de facto la disparition d’un corps de métier oublié, les « cercleurs » de roues.
– – – – – – – – – – –
Le pittoresque a toujours été présent chez nous.
Lorsque nous étions à « Village » (Etang-Salé-les-Bains), il y avait une belle vieille Malbaraise qui passait dans le sentier devant chez nous deux fois par semaine.
« A la bazaaaar, madame… bazaaaar » Elle arborait fièrement un grand panier plat sur son coco, chargé de salades, bringelles, tomates, z’oignons, l’ail, piment, carottes, pipangailles, etc. Largement de quoi assurer les repas de la semaine. Ses légumes n’étaient pas plus chers que ceux du vieux marché couvert de Saint-Louis.
Cette brave femme parcourait ainsi des dizaines de kilomètres, chaque semaine, chargée comme un baudet. Une image disparue de nos paysages. Il a fallu qu’intervienne ce foutu coro-machin-de-m… pour qu’on retrouve des humanistes, des gens assez courageux pour aller au-devant de leurs semblables.
Alain, Michel et moi adorions cette très grande dame, cette Malbaraise qui, à la saison, vendait aussi des goyaviers, suprême merveille.
La classe des vendeurs ambulants est infinie. Et souvent surprenante.
Qui se souvient des livreurs de lait ? Je vous ai déjà parlé de monsieur Caro, le papa de mon pote Camille, qui nous apportait chaque matin un litre de lait frais à peine tiré. Un lait d’une saveur inexprimable. Lorsqu’on le faisait bouillir, il fournissait une épaisse couche de crème. Il n’y a plus guère que le lait Piton-des-Neiges (pub gratuite) qui, aujourd’hui, me le rappelle. Tous les autres, sans exception, n’ont de lait que le nom.
Le temps des chaises-à-porteurs
Le Réunionnais, même sous des apparences parfois trompeuses, a toujours été d’une surprenante résistance physique. Ainsi, dans la liste de ces métiers disparus, les porteurs de chaises.
Les plus connus, cela remonte à très loin, restent ceux du Bras-de-Cilaos. Avant que ne fût construite la route que nous connaissons, le bitume venant de Saint-Louis s’arrêtait au-dessus de l’Îlet-Furcy. Mais le cirque connaissait déjà une certaine vogue avec ses eaux thermales, sa fraîcheur ; nombre de « gros Blancs » y allaient à la saison chaude.
Faire la grimpette à pinces, vous n’y pensez pas, mon bon ! Alors s’est mise en place la corporation des porteurs de chaises. Ils embarquaient leurs clients au petit matin, dans le lit de la rivière Saint-Etienne et c’était parti pour une journée de crapahut en hauteur. Soleil, pluie, froid, chaud, fallait assurer.
Ces gens d’une incroyable résistance formaient des tandems parfaitement acquis au travail en commun. « Ala la boue ! » disait le porteur de devant. « La boue partout ! » répliquait son dalon de derrière.
Lors de la pause de midi, à Pavillon, les « portés » se restauraient copieusement chez l’habitant, rougail boucané, lentilles, maïs-do-riz, fricassée brèdes chouchou, vin de Cilaos… Les « porteurs » avaient juste droit à un ti coup d’sec et in gazon d’riz èk piment crasé. Ils arrivaient à Cilaos à la tombée du jour. Les « portés » intégraient l’un de ces nombreux petits hôtels spécialement construits à leur intention, sinon leur « maison changement d’air » ; les porteurs recevaient leur (très) maigre rémunération et, une fois chez eux, moulus, fourbus, s’écroulaient sur leur paillasse, sachant n’avoir que jusqu’à une heure du matin pour reposer un peu leur carasse endolorie : car de grand matin le lendemain, re-belote.
Ces braves travailleurs de force durent reprendre du service après le cyclone-48, le pont entre Furcy et la route, laquelle avait été emportée par les crues de la rivière. Et là, non seulement, ils devaient faire le même travail que décrit ci-dessus mais, en outre, ils se chargeaient de porter à bras d’hommes les « clients » se révélant incapables de traverser les flots en furie par leurs propres moyens. Cela fonctionnait dans les deux sens. Personne n’a jamais péri lors de ce portage d’un genre imprévu.
Pendant longtemps cette corporation a subsisté au coeur-même de Cilaos avec les curistes impotents, incapables de descendre au fond du Bras-de-Cilaos où étaient installés les premiers Thermes. On en voyait plusieurs passer devant chez Mamie chaque matin, villa « Désirée », chemin des Chaises-à-Porteurs, justement.
Une belle statue, leur rendant hommage à juste titre, est installée devant la mairie.
« Coiffeur garage »
A l’époque du Mémorial, j’habitais à Grande-Montée. Ayant un très grand jardin avec basse-cour autour, je louais les services du vieux Milien, un brave homme désargenté prêt à tout, pourvu que ce fût honnête, pour ne devoir rien à personne. Il planta mon jardin de fond en comble, s’occupa de garnir mon poulailler et devint vite un ami. Un jour qu’il déjeunait à ma table autour d’un bon cari la patte-cochon, nous nous mîmes à discuter des jeunes (déjà !).
« Ça i vé pi faire rien ». Comptant sur ses doigts selon une pratique ancestrale, il précisa : « Ça i dépaille pas cannes, ça i fé pu d’jardin, ça i soigne pas z’animaux, ça i aide minm pu zot momon nettoye la case. Mais quand i passe devant la cantine, la bave i coule ».
Ce brave Milien venait d’un coup de rafraîchir mon vocabulaire créole : « la cantine », vieux nom local de la « boutique-Chinois ». Mais mon propos n’est pas là : Milien représentait à lui seul ces Créoles qui n’ont jamais compté que sur eux-mêmes pour manger et faire vivre leur famille. Un peu d’ingéniosité, de la débrouillardise et une farouche volonté d’utiliser ses dons naturels à 200%.
« Quand ou conné pas faire, monsieur Bénard, ou engarde bien sat’ i conné, ou appren’ ».
Après quoi il m’offrit une belle petite poule blanche, qui est morte de sa belle mort ; et refusa tout paiement : « Non ! Ou la invite à mwin manger. Ça, c’est mon coeur ça ! »
Vieux Milien ! Si tu savais comme je continue de t’aimer.
Je me souviens des paroles profondes de ce vieux sage en pensant à la débrouillardise des Créoles d’alors.
Vous avez connu les « coiffeurs dan’ garage » ? Ils avaient été employés comme apprentis chez des coiffeurs ayant pignon sur rue, avaient assimilé toutes les ficelles du métier, puis, comme un apprenti gagne à peine trois fois six sous, avaient voulu s’installer à leur compte. Mais pour ça, faut des moyens. Ils n’en avaient pas. Alors, vive le système C, équivalent tropical du système D.
Un local ? En cherchant bien… il y a tant de braves gens !
Il y avait à cent mètres de chez nous à La Rivirrrr, la belle maison du colonel Albéric Legros, ancien de la Coloniale à la voix forte et au moucatage redoutable. Il possédait sur le bord de la route un garage dont il n’avait nul besoin. Il en avait laissé gratuitement l’usage à un jeune coiffeur (coiffeur sans titre, cela va de soi). Ameublement sommaire : une chaise pour le client. Le matos était réduit à sa plus simple expression, une tondeuse (à main), un rasoir coupe-choux, un peigne aux incrustations indéfinissables, une paire de ciseaux et une brosse. Quant à la serviette autour du coup, mieux valait ne pas être trop regardant. D’ailleurs on s’en foutait royalement : personne n’a jamais chopé aucune m… Et quand je pense aux palinodies de l’ARS, je me demande bien à quoi sont payés ces crétins inopérants.
« Chez Turpin »
Tel quel, ce « coiffeur-garage » avait la clientèle peu fortunée de tout le Ruisseau (un des lieux-dits de La Rivirrrr), dont la nôtre. Pour deux excellentes raisons : ses tarifs étaient abordables et il ne coupait pas mal du tout, le bougre.
Il y avait un de ses congénères de garage, tout près de notre vieux lycée Leconte-de-Lisle, rue Dauphine. Pardon ! Rue du Général-De-Gaulle. Turpin. A la place où il officiait, il y a maintenant une pizzéria ou quelqu’autre salon de thé.
Turpin était un « petit coiffeur », un mètre cinquante bien pesé. Il était d’usage de moucater ceux qui utilisaient ses services. Comprenez que ce brave petit homme pratiquait alors les tarifs les plus bas de Saint-Denis. Donc forcément, étant donné la férocité des jeunes, ceux qui se faisaient coiffer chez lui ne pouvaient être que de classe inférieure. Et vas-y les quolibets !
Michel et moi, pour économiser notre argent de poche, nous sommes parfois faits coiffer chez Turpin. Un jeudi soir qu’un penku (pensionnaire) s’était foutu de notre coupe de cheveux, mon digne frangin te lui a mis un de ces pains dans la gueule !
Michel, alors, était loin de l’athlète qu’il est devenu, mais son coup d’poing té mauvais. Je crois que c’est à partir de cette correction qu’on a cessé de moucater le brave petit Figaro.
Je m’aperçois ici que cet article comporte bien plus de rubriques que je ne l’avais imaginé au départ. Il me faudra donc y revenir dans un second opus, sinon un deuxième, pour ceux qui connaissent encore le français. Mais avant de terminer ce volet, je voudrais évoquer la mémoire des écrivains publics.
Ceux que j’ai connus, moi, avaient par tâche essentielle de rédiger « la demande po rentrer ». Ces gens, qui savaient écrire, mais écrire « à peu près à peu près », écrivaient pour les amoureux désireux de se mettre dans les bonne grâces des parents de leur chérie. Il y avait des formes strictes à respecter.
Le prétendant donnait de sommaires indications à l’écrivain et ce dernier y allait de sa plus belle plume sergent-major.
« Monsieur Hoareau, madame Horeau, avec l’honneur et le respect, je vous demande pardon de vous demander la permission d’entrer dans votre maison pour rester assis à côté de mademoiselle Philomène votre fille, etc. etc., le jour que zot i veut… » La population ayant été longtemps analphabète, l’écrivain avait pas mal de boulot.
Je pense sincèrement qu’aujourd’hui, à l’heure où nos jeunes ne savent plus parler le français mais qui gaingn pu cause créole in merde, on pourrait remettre ce métier à l’honneur.
Il est patent qu’à cette évocation des métiers disparus, je parle beaucoup de moi-même. Je vous l’accorde volontiers mais… cela sera le 3è tome des « Souvenirs d’une enfance créole », c’est-à-dire les miens. Le vendeur de lait de Bras-Panon ne sera pas exactement le même que le papa de mon pote Camille Caro. Tout comme mon grand-oncle Léonus, du Sud, n’aura pas forcément la même attitude qu’un autre grand homme, admirable s’il en fût, Emile Hugot.
Si vos souvenirs ne suivent pas les mêmes clivages, rien ne vous empêche de nous en faire part. Je ne demande même que ça.
À suivre…