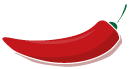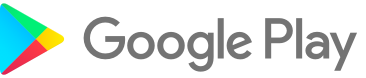Comme les marins, les premiers habitants de l’île ont aussi consommé les tortues existantes qui venaient pondre à La Réunion, jusqu’à leur disparition. « Comme il n’y avait plus de ponte, la consommation s’est arrêtée ou est devenue exceptionnelle, à part les quelque pêcheurs ou chasseurs sous-marins qui attrapaient les rares tortues aperçues. De ce fait, par rapport à d’autres régions du bassin indiaocéanique, la consommation de viande de tortue à La Réunion ne s’est pas implantée dans la durée », explique Stéphane Ciccionne.
De la tortue dans les cantines, restaurants, et conserves
Lancée dans les années 1970 dans l’île, l’élevage de tortues de mer pour la consommation de leur viande a duré une petite vingtaine d’années jusqu’à son interdiction en 1997. Portée par la Compagnie réunionnaise d’aquaculture et d’industrie littorale (Corail), la création de cette filière et de la ferme pilote de Saint-Leu en 1977 se voulait ambitieuse et tablait sur une production de plus de 1000 tonnes par an avec des tortues juvéniles prélevées dans leur milieu naturel dans les îles Éparses, Europa et Tromelin notamment. Mais déjà à cette époque, des voix commençaient à se faire entendre de la part des associations écologistes qui critiquaient cet élevage basé un modèle productiviste. « Lorsque l’élevage de tortue avait officiellement démarré dans les années 70 dans l’île, il avait fallu faire la promotion de la viande de tortue car les Réunionnais n’achetaient plus spontanément cette dernière et ce jusqu’à son interdiction dans les années 1990 », poursuit l’océanologue.
Alors qu’elle commençait à émerger localement, cette filière fera face à un contrecoup dès 1981 avec le classement des tortues marines à l’annexe I de la Convention de Washington qui limite fortement l’importation et l’exportation de tortues marines et qui en interdit le commerce international. Un second coup de semonce intervient en 1983 avec un arrêté préfectoral qui met en avant la nécessaire protection des tortues sauvages. Malgré les demandes de dérogation faites par l’État français pour le maintien de l’élevage en ranch qui ne mettrait pas an danger l’espèce, les oppositions à l’élevage comme les réglementations se durcissent et les débouchés commerciaux se réduisent comme peau de chagrin.
Reconversion
En 1989, les terrains et les bâtiments de la ferme Corail sont acquis par la Région Réunion qui ne souhaitait pas voir la filière disparaître. Malgré de multiples interventions auprès des ministères pour trouver un cadre juridique stable, le coup de grâce interviendra en 1994 lorsque le ministère de l’Environnement décide de stopper l’élevage commercial. Afin de permettre la reconversion de la ferme Corail, un moratoire est alors mis en place. En 1997, le conseil régional valide alors la transformation du site qui deviendra en 2006 le centre Kelonia que tout le monde connaît actuellement.
« On ne parle plus aujourd’hui de valorisation extractive des tortues et de leur consommation mais au contraire, on parle de valorisation non-extractive de l’espèce. Ce que l’on valorise, c’est l’image de la tortue en tant que symbole de la préservation des océans », indique Stéphane Ciccione.
Une évolution qui s’est faite « relativement bien dans le temps », ajoute le directeur de Kelonia. « On a laissé le temps et le choix aux salariés de faire cette évolution. Ils l’ont tous fait en conscience et je crois qu’ils ont bien épousé leurs nouvelles missions. Je crois également qu’il est beaucoup plus confortable d’être dans la position de quelqu’un qui protège les tortues plutôt que d’être dans la positon de quelqu’un qui tuait les tortues pour les manger », termine-t-il.