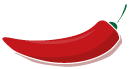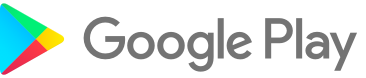1. Les faux débats de l’économie du développement
Je commencerais ainsi par une citation de mon livre de chevet, «La société contre l’Etat», de Pierre Clastres :
«Cela ne signifie évidemment pas que les sociétés archaïques ne le sont pas ; il s’agit simplement de pointer la vanité scientifique du concept d’économie de subsistance qui traduit beaucoup plus les attitudes et habitudes des observateurs occidentaux face aux sociétés primitives que la réalité économique sur quoi reposent ces cultures. Ce n’est en tout cas pas de ce que leur économie était de subsistance que les sociétés archaïques ont survécu en état d’extrême sous-développement jusqu’à nos jours. Il nous semble même qu’à ce compte-là c’est plutôt le prolétariat européen du XIXème siècle, illettré et sous-alimenté, qu’il faudrait qualifier d’archaïque. En réalité, l’idée même d’économie de subsistance ressortit au champ idéologique de l’Occident moderne, et nullement à l’Arsenal conceptuel d’une science. Et il est paradoxal de voir l’ethnologie elle-même victime d’une mystification aussi grossière, et d’autant plus redoutable qu’elle a contribué à orienter la stratégie des nations industrielles vis-à-vis du monde dit sous-développé.»
Pierre Clastres, dans «Copernic et les sauvages», «La société contre l’État», pages 13-14
Et c’est à travers cette citation de Pierre Clastres sur la pauvreté de certaines approches des économistes autour de la notion d’archaïsmes et des économies de subsistance, que je souhaite introduire mon sujet sur le développement.
Vous avez compris : je vais donc ci-après évoquer la nouvelle économie du développement, non pas au travers de Pierre Clastres, mon ethnologue préféré, mais plutôt à l’aune de la faiblesse des réflexions conceptuelles autour de l’économie du développement, et notamment au travers d’un des principaux acteurs français de ce milieu, l’Agence française de développement, un établissement public français de financement du développement qui selon moi, s’est énormément trompé en matière de développement.
Nota : Ce n’est pas le travail des milliers d’hommes et de femmes qui ont oeuvré depuis des décennies pour l’AFD, pour la CCCE ou pour la CCFOM (ces précédentes appellations) que je remets ici en cause, qui pour certains ont été mes amis, mais bien juste et uniquement l’AFD de salon, de conférence, qui s’affiche aujourd’hui, ces quelques grands barons du développement, depuis les arrivées de Severino et Rioux, qui dévient l’AFD de ce qu’elle devrait être : une agence de développement au service des pays africains, et non point une vitrine où certaines sommités s’exposent et se font mousser.
Dans le cas de la Reunion, l’AFD a eu une action décisive pour le développement de notre île, pour le développement du système financier de notre département jusque dans les années 1980, même si aujourd’hui, son rôle peut paraître bien insignifiant, bien faible. Ce n’est point de cette AFD là, des hommes et des femmes qui ont eu à cœur de developper notre île, mais aussi l’Afrique, dont je parle ici, mais des fossoyeurs de cette AFD sous le prétexte de s’afficher.
Mais au-delà des échecs de l’Agence française de développement, c’est toute l’économie du développement qui a échoué en Afrique, cette Terre d’élection des politiques de développement, qui, plus de soixante-dix ans après la fin de la seconde guerre mondiale, après plus de soixante-dix ans de politiques de développement conduites par l’AFD ou ses consœurs ou institutions approchantes, sous les diverses appellations précédentes de ces institutions, plus de soixante-dix ans plus tard, en 2023, l’Afrique demeure toujours un continent sous-développé, à l’exception peut-être de l’Afrique du Sud, avec des services publics sous-dimensionnés ou défaillants, ravagée par des guerres incessantes et à la merci désormais de groupements islamistes ou sécessionnistes.
2. Qu’appelle-t-on donc ‘économie du développement’ ?
Qu’appelle-t-on donc ‘économie du développement’ ? C’est une notion sur laquelle j’ai assez régulièrement écrit dans ce blog. Mais l’économie du développement étant une notion discutée déjà dans les années 1970, je souhaite discuter ici de ce que l’on peut appeler la ‘nouvelle économie du développement’, celle qui ne souhaite plus chercher à développer l’Afrique, ni parler de développement, pour ne plus donner prise à la critique et au jugement de ses propositions et de ses préconisations. À la suite d’Esther Duflo, la nouvelle économie du développement ne traite plus que des questions de ‘Genre’ et d’expérimentations sur des micro-questions de politique économique à de minuscules échelles, permettant à des économistes du développement de jouer le rôle de Dieu ou du Destin. Est-ce que tu t’en sortiras mieux si je te donne 100 euros tous les mois ou si je ne te les donne pas?
Évidemment, on connaît déjà tous la réponse à cette question. Mais il faut que les résultats de l’expérience soient observables et reproductibles, tout ceci pour que cette branche de l’économie puisse porter le nom de science expérimentale ou de science dure. Vaste fumisterie, abject enfumage. Tout ceci pour que certaines personnes puissent se prendre pour Dieu et puissent participer à des colloques où ils où elles seront longuement acclamés par leurs pairs, sans jamais avoir jamais aidé au développement d’une quelconque contrée lointaine et étrangère.
Ainsi la partie de l’article traitant de l’économie du développement de Wikipedia, au sujet de ce que l’article nomme «le micro-développement» :
«Depuis la fin des années 1990, certains économistes du développement (notamment Michael Kremer, Esther Duflo, Ted Miguel, Abhijit Banerjee, Sendhil Mullainathan, etc.) ont développé des outils pour appréhender les impacts des politiques économiques au niveau microscopique et du développement d’expériences sur le terrain comme méthode d’analyse des causalités en économie. Ils ont propulsé la théorie de la randomisation, l’évaluation aléatoire et insistent sur les projets comme les micro-projets comme une stratégie de développement efficace quand on s’y prend rationnellement.
Avérée comme instrument empirique, la randomisation a revitalisé la discipline de l’économie du développement. Beaucoup parlent déjà d’une sous-discipline de la science économique, l’économie du micro-développement. Toutefois, les critiques n’ont pas tardé, car les résultats de ces évaluations devraient être limités à la situation qu’ils analysent. Rien ne dit qu’une mesure qui a réussi en Inde réussira aussi au Mexique ou au Kenya. De plus, ces méthodes supposent que certaines mesures soient appliquées à une partie seulement de la population (et refusées à d’autres), ce qui pose un problème éthique.»
https://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_du_développement
Pour introduire plus avant ce concept d’économie du développement, je commencerais donc d’abord par me citer :
«Bien qu’une bonne partie du monde semble aspirer au développement, le terme lui même est critiqué par certains qui le considèrent trop centré sur les sociétés occidentales. Il impliquerait une direction et un mouvement que ces pays doivent suivre, elle impliquerait une infériorité des pays en développement.
Qu’est-ce donc que le développement ? Le concept de développement en économie est d’abord une notion moderne, qui repose sur l’hypothèse de l’existence de plusieurs groupes de pays dans le monde, certains étant considérés (ou présentés) comme des modèles économiques, d’autres étant considérés comme étant en retard en terme économique. Les uns, les pays occidentaux, étant appelés les pays développés ou industrialisés, et les autres, les pays du Tiers Monde, étant nommés soit ‘pays en voie de développement’ (ou ‘pays en développement’ ou ‘pays émergents’) soit ‘pays sous développés’.
Le concept de développement traduit ainsi ce phénomène de rattrapage en terme économique mais également humain, c’est-à-dire en terme d’industrialisation, de niveau de vie et aujourd’hui en terme de qualité de vie et d’accès aux biens publics que sont la santé, l’eau potable, l’électricité voire les infrastructures publiques. Voilà ce que recouvre le vocable de développement. Les pays aujourd’hui dits développés étaient il y a deux siècles à un stade non industrialisé, et ils ont enregistré au cours du dix-neuvième siècle et du vingtième siècle un processus de développement économique, technique, démographique, social et structurel.
Le développement devrait ainsi être un processus itératif vertueux, permettant aux pays restants du monde de rattraper de manière accélérée le niveau d’industrialisation et de vie des pays dits développés. Cette pensée économique a été mise en application essentiellement à partir des grands mouvements de décolonisation en Afrique et en Asie dès la fin de la seconde guerre mondiale, même si elle a pris initialement sa source dans la pensée de Karl Marx, et qu’elle a longtemps reposé notamment sur la vulgate marxiste.
Pourtant aujourd’hui, avec la disparition de l’Union Soviétique et avec la généralisation du modèle libéral, le développement n’a pratiquement plus rien à voir avec le marxisme, et ne résonne plus que des concepts de marchés, de libéralisme et de privatisations.»
Réflexion zéro
https://saucrates.blog4ever.com/du-developpement-1
3. En quoi l’aide au développement est-elle une vitrine, un outil du développement
Pour en revenir à l’Agence française de développement et sa vision du développement, celle-ci organise régulièrement des séminaires sur l’aide au développement et sur les concepts de développement, ou des rencontres avec des personnalités. L’une de ces dernières publications reposait sur l’idée que le développement de l’Afrique ne pouvait passer que par les commons… ou biens communs. Très vieille idée popularisée à l’origine par cette fable sur la tragédie des communs, et qui veut qu’aujourd’hui, dans notre monde moderne, tout devient biens communs, tout devient communauté et tout devient interconnecté. Même un peuple imaginaire resté à l’abri de tout contact avec le reste de l’humanité se trouverait confronté, concerné aux événements cataclysmiques causés par l’action du reste de l’humanité. Et c’est évidemment encore plus vrai en Afrique, confronté à des services publics et à des infrastructures publiques moins robustes, moins bien dimensionnées, moins efficients et moins efficaces qu’en Occident ou ailleurs.
Ainsi, l’AFD présentait aujourd’hui à Paris le dernier ouvrage de Kako Nubukpo intitulé «Une solution pour l’Afrique, du néoprotectionnisme aux biens communs», avec un débat avec Thomas Melonio, grand ponte de l’AFD, directeur exécutif du département de l’innovation, de la stratégie et de la recherche (titre bien ronflant à souhait …).
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/une-solution-pour-l-afrique_9782738155184.php
Au fond je rejoins parfaitement le diagnostic d’échec du développement du territoire africain par les recettes actuelles de l’économie du développement, même si je ne vois pas de sens aux solutions préconisées en lien avec les ‘commons’. Mais au fond, tout ceci n’est que du mercantilisme réciproque ; permettre à un auteur de vendre des bouquins et de se faire mousser, et pour l’AFD, s’afficher comme l’endroit qui réfléchit au développement. Malgré les centaines de pointures du département de l’innovation, de la stratégie et de la recherche de M. Thomas Melonio.
4. Tragédie du développement et biens communs
Pour en revenir aux communs (ou ‘commons’), la tragédie des communs est un concept décrivant un phénomène collectif de surexploitation d’une ressource commune, popularisé par un article de Garret Hardin paru en 1968. On retrouvait d’ailleurs cette même idée sous la plume de l’économiste anglais William Forster Lloyd qui publiait un essai en 1833 sur un pâturage sur des terres communes en Grande-Bretagne.
La tragédie des biens communs concernent ainsi la gestion de Biens communs comme des terres de pâturage, des lacs, des océans, c’est-à-dire des ressources le plus souvent naturelles (mais pas forcément comme par exemple la bande passante d’internet), qui sont en libre accès ou appartiennent à des communautés et que le libre jeu de la concurrence, ou l’usage normal par les hommes, conduira à la surexploitation puis à la disparition de cette ressource. Plusieurs pistes sont étudiées par Garret Hardin ou l’économie du développement : nationalisation, privatisation ou gestion par les communautés.
C’est cette dernière piste qui est évoquée par l’Agence française de développement, même si tout ceci est aussi ancien que le monde. L’Agence française de développement et ses chercheurs ne sont ainsi que des prestidigitateurs cherchant à faire croire qu’ils agissent et réfléchissent profondément et sérieusement pour le bien du monde (d’où leur symbole et leur maxime d’un monde en commun). Tout ceci est ancien comme le monde et sans intérêt ni apport intellectuel ; la majorité des biens communs ne peuvent être contrôlés entièrement par des communautés, qui ne peuvent d’ailleurs pas plus les entretenir par manque de moyens ou de capacité. Nous sommes nous-mêmes, l’ensemble des sociétés occidentales, incapables de freiner la pollution des océans globaux et la dilution des plastiques qui en découlent et leur diffusion dans l’ensemble des chaînes alimentaires marines.
Tout bien commun est supposé être surexploité, accaparé par une fraction de ses usagers, et disparaître. La privatisation de ce bien commun permettra certes d’intéresser un groupe à sa préservation, ou au contraire, à son utilisation pour le bénéfice exclusif de ce groupe, de cette entreprise. Quant à sa nationalisation, c’est sans compter les risques issus de la prévarication des agents publics et des gouvernements, de telle sorte que le plus souvent, ce bien commun sera accaparé par quelques usagers avec la bénédiction des États qui étaient sensés les protéger. En somme, comme une privatisation mais avec d’autres types de coût pour les profiteurs. Et par ailleurs, la majeure partie des biens communs ne peuvent être contrôlés ou protégés même par un État.
L’humanité et l’économie du développement buttent ainsi sur plusieurs écueils qui se nomment ‘tragédie des communs’, ‘tragédie des comportements des passagers clandestins’, et ‘intérêts collectifs’. Comment sauver un monde où les humains ne cherchent qu’à consommer et profiter le plus possible, sans participer en aucune manière à la création, à l’entretien et à la préservation des biens communs indispensables à la vie et à la poursuite de la vie ?
5. Pauvreté de la réflexion écologiste en matière de développement
Plutôt que d’éduquer l’humanité, les écologistes de tout crin ne cherchent qu’à imposer des règles et des comportements qu’ils considèrent comme bons, biens, se basant sur leur seule opinion, leur seule considération, se prenant eux aussi, également, pour des Dieux qui sauraient ce qui est BON, BIEN (tout ce qu’ils font) et ce qui est MAL (tout ce qu’ils n’aiment pas ou tout ce qu’ils ne font pas, ou bien tout ce qu’ils se réservent à eux seuls).
L’économie du développement pour sa part n’a rien réussi à proposer pour sortir de cette impasse économique et écologique. Si ce n’est de basculer dans l’hystérie écologique de ceux qui se prennent pour des Dieux et décident de ce qu’il est BON de faire et de ce qu’il est inversement MAUVAIS de faire.
Soixante-dix ans d’échecs et de tentatives ratées en territoire africain ne permettent même pas à cette économie du développement de proposer une idée qui puisse fonctionner en Afrique. Mais de toute façon, connaît-on un seul pays au monde qui ait pu réussir son décollage économique avec une natalité aussi explosive que celle de l’ensemble de l’Afrique et des états africains ? Non, ni la Chine, ni l’Inde, ni le Japon, ni les Tigres et Dragons asiatiques ne se sont développés sans avoir d’abord limité drastiquement leurs naissances, que ce soit coercitivement comme en Chine ou culturellement comme en Inde.
C’est le constat présenté par Kako Nubukpo lorsqu’il écrit dans la fiche de présentation de son livre : «L’Afrique est soumise à un défi gigantesque : intégrer en une génération un milliard d’individus supplémentaires dans un contexte de faible productivité, de quasi-absence d’industrie, d’urbanisation accélérée, le tout coiffé par une crise climatique devenue permanente.»
Face à une humanité se reproduisant à la manière d’un virus, et qui se répand comme un cancer à la surface de la planète, face à des ressources communes en voie d’extinction, face à des biens communs surexploités, quelles solutions peut apporter l’économie du développement ? Face par ailleurs à un impensé de l’économie : la guerre et les invasions humaines, et ses impacts et conséquences sur l’économie et l’évolution des sociétés ?
La réponse n’est pas tant en une économie plus juste, plus éthique, imposant aux principaux acteurs économiques (occidentaux le plus souvent) la préservation des ressources et des biens publics, mais plutôt en la mise en œuvre de règles contraignantes à l’échelle mondiale pour bloquer la croissance démographique de l’humanité, par tous les moyens possibles. Il faut sortir de l’éthique religieuse du ‘croître et se multiplier’. Il faut sortir du sacro-saint marché efficient et autorégulateur et de la non moins divine main invisible organisant le marché.