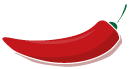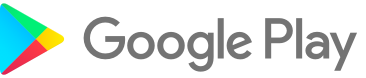(Mille excuses si je vous d’mande pardon pour cette attente : la dengue ; et ce n’est pas un prétexte diplomatique, merci !)
Je ne pensais pas que ce séjour à Mafate allait aussi rapidement donner un tour nouveau à mon existence. Je savais que j’allais abandonner l’enseignement ; j’y étais fermement décidé. J’attendais juste l’opportunité.
Justy et Mamie poussaient de hauts cris chaque fois que j’évoquais la question : j’avais un emploi sûr, j’étais bien payé, toutes choses vraies. Mais j’étais déjà au 9è échelon du métier et il n’y en a que 11. Pour aller où après ? Stagner ? Devenir directeur ? Cela aurait une possibilité mais je n’avais envie de commander à personne, moi.
À cette époque, les différents corps de métiers de l’enseignement n’étaient pas si cloisonnés que maintenant. Je me souviens ainsi qu’un des derniers vice-recteurs de l’île, M. Boyer (un Boyer pas créole) avait commencé par être instituteur, il l’avait lui-même affirmé à l’ORTF. C’était une perspective enthousiasmante, soit. Je n’étais pas plus con (silence là-bas !) qu’un autre sinon moins con que beaucoup. Mais je ne m’y voyais franchement pas, nourrissant depuis toujours une profonde aversion pour le corps de « ceux qui nous gouvernent ».
« Le » concours de l’ADER
J’avais voulu, vraiment voulu être flic mais y avais renoncé au dernier moment. J’aurais voulu être musicien mais des copains surdoués, Alain Bastide, Max Dormeuil, Harry Pitou and so on, m’avaient fichu tant de complexes ; conscient de n’être qu’un modeste amateur, j’avais raisonnablement compris que ce n’était pas fait pour moi : j’ai toujours su ne pas dépasser mon seuil d’incompétence.
J’avais aussi rêvé d’écrire. Et ça, les enfants, personne ne m’avais prouvé que c’était hors de mes moyens. Les événements allaient se charger de me rappeler, à Marla, que c’était encore envisageable.
La genèse de ma mutation personnelle remonte à La Sakay.
Là-bas, je m’étais mis en tête que j’allais écrire. Pas n’importe quoi : des polars. Le soir, après avoir corrigé les devoirs de la journée et préparé les cours du lendemain, j’avais entrepris d’écrire un « vrai » (vrai… pour moi !), un vrai roman policier intitulé « Neige sur La Réunion ». Très content de moi après avoir écrit le mot « FIN », je l’avais expédié à quarante éditeurs de France et de Navarre. Qui m’avaient tous répondu très gentiment :
« Malgré ses grandes qualités, votre roman n’entre pas dans le cadre de nos collections ». Prends ça po toué !
J’en conclus donc que si tous jugeaient que mon livre était si mauvais, c’est qu’il l’était.
Revenu à La Réunion, ne voulant pas perdre le scénario de base, j’avais décidé de le transformer en manière de Bob Morane tropical, roman pour adolescents. Le scénario s’y prêtait bien. Ce qui fut vite fait puis je quittai Étang-Salé pour Mafate. Où je reçus un courrier m’apprenant que mon manuscrit avait été distingué par l’ADER (Association des écrivains réunionnais) ; laquelle ADER, par les voix des Ferrère, Bled et Gili, m’apprenait qu’elle avait d’office inscrit mon roman au concours organisé par elle.
Je n’y croyais pas. Ils étaient trop gentils, ces gars-là.
Quelques semaines après, second courrier de l’ADER : j’avais le Prix du roman policier. Ce roman refusé par tous les éditeurs spécialisés dans le polar, s’octroyait le prix du même nom alors qu’il n’était plus qu’un roman pour ados.
CKC, Vangell, Vax, Le Quotidien…
Mon prix me fut remis par la grande Catherine Lavaux (vous jugez de ma fierté), pendant que mon pote Cazal (flic, gentil) recevait le Prix du roman pour un très beau livre, « Isabelle, ouvre les volets ». Et Antoine « Debois » (Deboisvilliers) le Prix de poésie.
Ce fut mon benjamin Alain qui m’ouvrit les portes de la félicité. Il travaillait alors à l’ex-BNCI et m’apprit que CKC créait Le Quotidien de La Réunion.
« Présente-leur ton bouquin, couillon ! » Oui, on s’aime…
Je le pris au mot et allai voir Didier Vangell, ex-présentateur du JT de RFO et futur rédacteur-en-chef du Quotidien. Il accepta d’emblée, « gracieusement », a-t-il précisé. C’est ainsi que dès son premier numéro, octobre 1976, Le Quotidien renoua avec l’antique tradition des romans-feuilletons de la presse français, avec « Neige sur La Réunion ».
Avant de me laisser repartir à Marla, Daniel Vaxelaire, futur chef des informations locales du canard en gestation, me fit appeler. N’en perdant jamais une, et puisque j’habitais là-haut, il me demanda de lui écrire quelque chose sur le futur désenclavement de Mafate et cette route qui faisait tant bondir les amateurs de trekking.
Ce que je fis contre l’avis de H.G., vous savez, le « maître » du chien exécrable.
« Attention à ou, hein ! Dis pas de mal de monsieur Miguet ! Sinon, attention pangar… » Loin de moi cette intention : Miguet fut le seul à proférer des mots aimables envers les instituteurs de là-haut ! Si je devais dire du mal de quelqu’un de l’ONF, c’était bien de H.G. Chose faite désormais.
J’envoyai à Vax son article, qui fut publié dès réception.
Ce qui me donna des idées.
Instit’ 7.500 ; journaliste 3.500 !
J’avoue qu’il y a un paradoxe entre le fait de vivre dans un cadre idyllique, La Nouvelle, et rêver de replonger dans l’enfer des villes. Mais je suis comme beaucoup, bourré de contradictions. Le soir, ainsi, je rêvais de journaux et autres machines à écrire ; en massacrant « Saturday night shuffle » de Dadi sur mon Ibanez Jumbo J-200.
N’y tenant plus, un matin avant de reprendre mes classes à La Nouvelle, je sautai sur le téléphone de l’ONF et appelai Didier Vangell :
« Vous avez un poste pour moi ? »
Sa réponse fusa :
« Pourquoi pas ! »
« Bon… j’arrive » fut tout ce que je pus bafouiller sous le coup de l’émotion.
Mon étonnement devant cet acquiescement si rapide ne dura guère ; après tout, il savait que je savais écrire. Pour ce qui était des techniques du journalisme, ils se chargeraient bien de me dégrossir.
Quant à moi, mon siège était fait. Enseignant, journaliste, cela participe de la même vocation. On apprend quelque chose, on entend, on écoute, on comprend et on transmet.
La question « pognon » était autrement cruciale : je savais qu’en abandonnant l’enseignement pour l’écriture, j’allais gagner deux fois moins ; je passais de 7.500 francs à 3.500. Cela ne m’a pas chatouillé une seconde. Le plaisir compte autant que la paye. Du moins pour moi. Faut-il être con !
Mais comme chaque fois que j’ai opéré des choix délirants, je ne l’ai JAMAIS regretté.
« Massacre ta machine si tu es énervé, mais pas trop ! »
De toute façon, même si j’avais eu le moindre doute sur la bonne santé de mes neurones, « les autres » allaient se charger de me les remettre dans le bon sens. Les autres ? Une sacrée équipe de jeunes tirant sur tout ce qui bougeait, dotés d’un enthousiasme terriblement contagieux. « La droite, la gauche, même le bon Dieu… mon vieux » ! (inside joke)
Ma première, seule et définitive leçon de journalisme, je la reçus plein la gueule pour pas un rond, de mon ami Daniel Vaxelaire. Il était mon chef hiérarchique. Il m’expédia, le premier jour, sur une exposition de peinture au musée Léon Dierx.
« Ben… je fais quoi ?
- Tu y vas, tu poses des questions et tu te démerdes !
Du Vax tout craché.
Outre Daniel, il y eut Idriss Issa, une sacrée plume comme on dit, qui me donna bien des conseils sur la meilleure façon de ne pas se planter. Alain Lemée, chef des informations générales, qui se chargea de mettre en confiance le petit dernier : « Massacre ta machine quand tu es énervé, mais pas trop : CKC n’aime pas ça. Et dis-toi que tu n’es pas plus mauvais qu’un autre ».
L’affaire Darmalingom
Un événement m’a marqué à jamais dès mes premiers pas de journaliste, un procès d’Assises. « L’affaire Darmalingom ».
Ce mineur de 18 ans (mineur à l’époque) avait emmené une jeune fille au Maïdo, l’avait violée puis étranglée. Il risquait la peine de mort. Je me demande encore aujourd’hui pourquoi ce con de Vax m’a choisi, moi, le petit dernier, pour couvrir le procès. Trop dur pour moi. Le genre de reportage, si tu le loupes, à te sabrer définitivement dans le métier.
La partie civile était soutenue par le grand Me Salez et pour sauver la tête de l’accusé, sa famille avait fait appel à un génie du barreau français, Me Isorni en personne.
Le procès ne dura qu’une journée mais se prolongea jusque fort tard dans la nuit.
Il est une phrase dont je me souviens jusqu’à maintenant. Elle émane du grand Isorni, lequel n’a jamais joué perdant d’avance.
Fut-ce en désespoir de cause ? Fut-ce calculé à la virgule près ? L’avocat a dit :
« Mais pourquoi a-t-il aimé comme une femme cette fille qui n’en était pas une ? Parce que lui-même n’est pas un homme ! »
Je pense que c’est cette envolée qui a sauvé la tête de Darmalingom : perpétuité.
Il devait être dans les 22 heures lorsque je revins au Chaudron. Me demandant comment j’allais faire pour écrire et discuter avec les techniciens, maquettistes etc. Car on m’avait dit qu’on attendrait mon papier pour lancer le canard du lendemain. Tu parles si je fouettais sévère.
Ils étaient tous là !
« Alors ? » m’ont-ils demandé à l’unisson. « Perpète ».
La UNE du lendemain :
« Il a sauvé sa tête »
Coups durs au Quotidien
Comment voulez-vous que des trucs de ce calibre ne vous imprègnent pas pour l’éternité !
Si je m’attarde précisément sur ce type d’événements qui n’ont, en apparence, rien à voir avec mes années à Mafate, c’est précisément parce qu’ils ont fait prendre à ma vie un tour nouveau. Mais que je vous rassure, je reviens à Mafate, sans tarder.
Cette première période au Quotidien n’allait malheureusement pas durer. Le Quotidien a bien failli payer le prix de son indépendance d’esprit. Avant lui, il n’y avait, en fait d’information, que deux visions politiques des faits : la droite et le communisme ; le JIR et Témoignages.
Et voici que ces jeunes trouble-fêtee prétendaient donner, imposer une autre façon de voir les choses ? Ils prétendaient donner la parole à tout le monde ? D’ailleurs, un de leur slogans de lancement n’était-il pas : « Soyez mieux informés » ? Non mais !
Je n’avais pas eu à attendre ces douloureux événements pour démissionner : il m’était impossible de concilier ma passion pour ce nouveau métier et ma vie conjugale. Mon épouse d’alors était en effet restée à Mafate en attendant mieux. Un mieux qui ne venait pas ; nous ne nous rencontrions que le week-end… frustrant. Je demandai donc à l’inspecteur de me réexpédier à Marla, ce qu’il accepta de grand coeur.
Lorsque j’expliquai à Didier Vangell les raisons de mon abandon, il me dit avec gentillesse que si lui, rédacteur-en-chef, devait choisir entre sa vie familiale et son poste, il n’hésiterait pas non plus une seule seconde.
Sac au dos, Julot !
Un emploi du temps en forme de tapis mendiant !
Coup de bol, l’école de Marla étant composée de deux classes multiples (une galère, ces classes multiples !), mon épouse obtint enfin la nomination qu’elle attendait depuis des mois. Nous occupâmes donc l’école « en famille ».
À elle les petits, C.P. et CE 1 ; à moi les autres, CE 2, CM 1, CM 2 et Fin d’études. Ces classes multiples n’existent plus, je crois. À l’époque, c’était monnaie courante. Je me rappelle que Zalan, ancien maire de L’Entre-Deux, lorsqu’il rentra de Madagascar, fut nommé à l’étage du marché de Saint-Benoît, seul espace assez vaste pour accueillir sa classe (très) multiple de … 150 élèves. Du C.P. à la Fin d’études, pas de mollesse.
Fallait jongler avec les emplois du temps et les différents niveaux ; faire travailler les uns par écrit pendant qu’on faisait parler et réciter les autres, etc. Ce qui laissait au pédagogue la nette impression d’être un de ces extra-terrestres chers à Gotlib, à têtes multiples dont les yeux jouent les caméléons ; pendant que les bras multiples soulignent les fautes dans un cahier, écrivent au tableau noir, i tir in carabi par-ici, i pose in’ division par-là, en même temps. Le grand emploi du temps mural ? Avec plein de colonnes et de subdivisions colorées comme in l’endormi, il ressemblait à un tapis mendiant. Ça vous forge un caractère d’enfer, y’a pas à chiquer !
Les conditions matérielles étaient des plus sommaires. On finit par nous accorder deux pièces dans le logement de passage des agents de l’ONF. Il y avait un bâtiment en bois-sous-tôle au sol bien dallé et aussi nu qu’une fesse de bébé. Juste une table qui nous servait à corriger les cahiers, préparer les leçons du lendemain, et casser la graine. Et une petite pièce censée servir de chambre.
Pour avoir un lit, je commandai six planches de tamarin à mon copain Giroday, dont l’épouse tient aujourd’hui une splendide table d’hôtes. Il alla les scier dans le Kelval. Je piochai ici et là une dizaine de pierres artificielles datant de la construction de l’école. Le matelas ? Nous profitâmes du voyage d’un planteur à Cilaos et ce fut son boeuf qui nous rapporta notre matelas en fin de journée. Sommaire ? Bah ! S’il fallait se laisser chagriner par d’aussi basses considérations…
La pointe tété i détaque baro
Pour les « commodités », c’était encore plus dépouillé. Et quand je dis dépouillé…
Il y avait un petit bâtiment, en « tôle sous tôle » cette fois, de deux pièces d’à peu près 2 mètres sur 2 chacune. L’une pour la cuisine, au feu de bois comme on s’y attend. Il y avait deux rails scellés dans la maçonnerie… et rien d’autre. Pour le combustible, j’achetai simplement le bois d’acacia aux paysans du coin ; chacun son tour, pour éviter ressentiments et jalousies diverses.
La seule ouverture étant la porte, ça boucanait à l’envi là-dedans, voir photo. L’avantage était qu’en achetant la viande de porc ou de boeuf à mes amis paysans, je pouvais fumer les viandes en toute sérénité. Je me fumais aussi mais là est une autre affaire.
Vous connaissez l’aphorisme de ce malicieux de Gainsbourg : « L’alcool conserve les fruits et la fumée les viandes ». Prends-en de la graine, Ti-Jules.
Le réduit attenant était la salle d’eau. Avec, en tout et pour tout, un robinet que je savais branché directement à une petite source en-dessous du Taïbit. Autrement dit à pas loin de 2.300 mètres ! Le matin, en hiver, on s’attendait à voir des glaçons sortir du robinet. Inutile de vous dire que bien souvent, je ne pris ma douche que vers midi. Ma compagne était bien plus courageuse. Résultat, quand elle entrait en classe le matin, la pointe tété té détaque baro…
L’enseignement phagocytait l’essentiel de nos journées. Normal ! Nous étions les premiers enseignants permanents et volontaires du coin ; il y avait un retard énorme à rattraper et nous y mettions réellement du coeur. Cela n’avait rien d’épuisant au demeurant : nos élèves étaient d’une gentillesse et d’une bonne volonté merveilleuses. Et nous avions à coeur de ne pas décevoir leurs parents, vite devenus des amis.
Il ne se passait pas un week-end sans que nous ne fussions invités « à casse in’ ti manger la case, siouplaît ! » Le souci était de partager les invitations, là encore afin que nul ne se vexât.
Quand je dis « ti manger », il s’agissait plutôt de monstrueuses agapes soigneusement arrosées, de ces invitations dans lesquelles les hôtes mettent toute leur courtoisie et toute leur science culinaire au service de leurs invités. Et pour vous mettre à l’aise, ils savaient y faire, mes amis des seventies !
Où l’inspecteur Soutric débarque en hélico. Surpriiiiise !
Pour occuper le reste du temps, nous avions ce qu’il fallait. Nous avions pris soin d’apporter à Marla un jeu d’échecs, un jeu de dames, un Super Master Mind (qui connaît encore ça ?), deux guitares folk Ibanez, imitations parfaites de la Gibson J-200 et de la Dove. Je te taillais du Dadi comme qui rigole et ma compagne commençait à bien s’y mettre aussi. Plus les compils complètes en cassettes des Shadows, Brassens, Elvis, Armstrong, Bechet, and so on. Et plus si affinités, les nuits sont si longues…
Nous faisions notre ordinaire de ce que nos amis mafatais nous proposaient. Entre les fameux z’haricots de Marla (une merveille), petits pois frais, lentilles de Cilaos : la moitié des lentilles de Cilaos viennent de Marla, La Nouvelle, la Plaine-des-Sables (pas la même que l’autre) Îlet-à-Cordes, et volailles-pays diverses. Nous payions tout rubis-sur-l’ongle, bien sûr.
Je ne me souviens pas avoir mangé autant de plats de z’endettes frites de ma vie. Ni de patates chouchou, délicieuses. Quant aux saucisse fabriquées lorsqu’un’ ti cochon noir y laissait sa peau, c’était à l’ancienne, épaisses comme cabo mulet.
Quand l’un d’eux se préparait à tuer son ti cochon noir, j’étais le premier prévenu. Ils savaient que j’avais les moyens de payer comptant tout ce que je réserverai… Alors, j’y allais de bon coeur. Je me réservais une cuisse, des côtelettes, les filets mignons, les pattes. Plus la panse et la tête. Vous devinez la suite ?
J’ai déjà expliqué ailleurs la recette du vrai fromage de tête. Ben, les enfants, ça me coûtait une nuit sans sommeil et une vingtaine de dodos (faut bien agrémenter les nuits blanches auprès du feu), mais le résultat valait une médaille d’Or au Concours agricole, je n’en remercierai jamais assez ma vieille Mamie-de-Cilaos et Ida.
Notez que ce fromage-cochon ne durait jamais longtemps : très fier de moi, j’en distribuais (je ne vendais pas !) à mes amis paysans. L’amitié, la vraie, est aussi faite de ces petits riens qui font chaud au coeur.
Parfois, plus rarement, il s’abattait un boeuf à Marla. Nous en faisons bonne provision aussi car notre vieille nénène Ida m’avait appris que « boucané bèf lé encore plus meuilleur boucané cochon ! » Je vais vous faire un aveu mais ne l’ébruitez pas : c’est vrai.
Et puis, pensez donc : vous achetez les filets, les faux du même nom, les araignées, quelques basses-côtes, le plat-de-côte (idéal pour le romazava), et vous laissez tout ce petit monde faisander à l’air libre… Ça, tonton, c’est de la baraque comme seuls savent l’apprécier les vrais viandards !
Avec nos élèves, nous n’avons jamais eu le moindre souci d’apprentissage. Si désireux de combler des retards dont ils avaient parfaitement conscience qu’il n’y avait aucun souci de discipline. Ils voulaient savoir, ils aimaient apprendre, contrairement à ce que l’on a pu croire et prétendre trop souvent. Ils n’avaient jamais vu la mer mais ne demandaient que ça.
Nous avions vite admis que la langue créole, loin d’être un frein, se révélait un avantage précieux. Ils ne comprenaient pas une phrase en français ? Qu’à cela ne tienne, je la répétais en créole, leur expliquais le pourquoi du comment, et ça marchait. Eux, en échange, nous apprenaient à distinguer les plantes.
Ce qu’a pu constater l’inspecteur Soutric, le redoutable Soutric, venu un jour m’inspecter par surprise… en hélicoptère. Il m’engueula d’importance à la fin de la journée et… augmenta de deux points ma note pédagogique, parce que j’avais su instaurer une pédagogie de confiance avec mes ouailles, écrivit-il dans son rapport.
Là-haut, on revient à l’essentiel de l’existence
La vie est faite de ces imprévus… Un jour que je demandais à Expédit comment ils faisaient pour construire leurs cases avec des angles droits apparemment si parfaits, il me donna (me « flanqua » serait plus approprié) une leçon de « géométrie su l’tas ».
Géométrie appliquée, empirique, si vous préférez.
« Hein, Jules, ou prend trois ficelles. In’ i fé 3 mèt’, in’ aut’ i fé 4 mèt’, dernier i fé 5 mèt’. Ou mett’ les 3 ensemb’ et i fé l’ang’ droite minm ».
De retour dans l’appentis me servant de maison, j’appelai à moi les mânes de Pythagore pour constater que son théorème, ben ! l’Expédit, il l’appliquait comme M. Jourdain avec sa prose. Le carré de l’hypomachin etc., vous vous rappelez ? 3X3 = 9… 4X4 = 16… 9+16 = 25…
Cela me rappelle que plus tard, un brave paysan illettré de la Plaine-des-Cafres m’expliqua pourquoi carottes et salades ne se plantent jamais au même moment. Comme Expédit me l’avait dit.
Il y a des fois où l’on se sent con de se croire futé !
Nous étions si bien là-haut, qu’au lieu de regagner le littoral chaque samedi, nous n’en sortions qu’une fois par mois. Pour les commissions essentielles à Cilaos, nous donnions l’argent à quelque paysan et il nous les rapportait à dos de boeuf. Juste l’indispensable ; car en ces retraites inespérées, on en revient vite à l’essentiel. Dans cet essentiel, il y a le regard de l’autre, la chaleur de sa voix, sa main tendue, son sourire sans faux-fuyant.
Ça remet les choses à leur juste place. Cela m’a donné un moral d’enfer pour aborder mon existence à venir.
Fin de l’année scolaire 76/77, je démissionnai définitivement cette fois. Moral au top niveau ; le foie un peu moins… Direction Mayotte.
Je dédie cet article à Lucie et Jean-Paul.