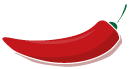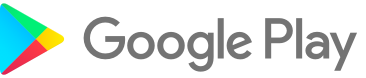Le bac d’aujourd’hui, avec ses kyrielles de mentions toutes plus improbables les unes que les autres, n’est, à tout prendre qu’un passeport pour un pays mystérieux appelé l’Université. Après les éclats de rire et les pleurs du jour des résultats, faut y aller. À la fin de la première année, les deux tiers des étudiants s’en vont vers la vie active, s’apercevant mais un peu tard que les lycées ne leur ont pas donné les connaissances suffisantes ni les facultés de raisonnement nécessaires pour se dépêtrer en Fac.
Leur peau d’âne, à force de rétrécir, a fini par disparaître dans les limbes des fumeux programmes scolaires. Les enseignants, je précise, n’y sont pour rien: ils appliquent des programmes voulus par des imbéciles galonnés appelés ministres.
Il fut un temps où il en allait tout autrement.
Le bac? Un tapis rouge!
J’ai passé mon bac en 1966. Avec mention, s’il-vous-plaît: « passable », point barre. Qu’est-ce que je me foutais, de cette mention, non mais qu’est-ce que je m’en contrefoutais ! D’ailleurs, 99 % des candidats s’en sortaient comme moi. Je me souviens que mon pote Zalan avait eu la mention « assez bien », comme mon futur ex-beau-frère, Yves Thébault. Je n’en ai pas été jaloux une fraction de seconde ; j’avais mon sauf-conduit pour tout ce que je voulais.
Car c’était ça, alors, le bac: un tapis rouge déroulé sous nos pas, un boulevard pour la vie active. Non seulement il était le sésame pour la Fac mais, comme il fallait bien se nourrir en étudiant, il était aussi l’ouverture vers toutes sortes de métiers, voire de concours qui, de nos jours, nécessitent des bac + 5 ou 6.
Pour une raison bien simple : avec les connaissances acquises en Terminale et la façon de les rapporter, on pouvait empoigner la vie à bras-le-corps. Et nous en étions tous fermement décidés.
J’ai eu nombre de copains qui, bac en poche, se sont fait embaucher en qualité d’instituteurs remplaçants. Après deux années de pratique, ils pouvaient se présenter au concours interne et obtenir leur CAP d’instituteur primaire. Ce fut d’ailleurs mon cas mais bien plus tard et ceci est une autre histoire.
On pouvait également aborder, après une petite préparation par correspondance (l’École universelle, les Préparations Francis-Lefèvre, Eurélec etc.), se présenter à des concours comme Inspecteur-élève des Impôts, du Trésor, Inspecteur de police, concours qui nécessitent de nos jours in tacon d’années de Fac aussi épuisantes qu’incertaines. C’est ainsi que quelques années plus tard j’allais me présenter au concours d’Inspecteur de police… et y être reçu, mais je vous la raconterai dans un autre récit de mes errances aussi diverses que variées. Il faut pour ça, aujourd’hui, une licence. Moi, ce que je voulais, c’était bosser. N’importe quoi mais bosser… et avoir le fric idoine et adéquat (oups!)
Et c’est là où je veux en venir…
Raymond Barre, chiant comme c’est pas permis!
Pendant mon année de Philo, j’avais fortement déçu Justy en lui apprenant que je ne voulais plus du tout devenir médecin comme elle m’avait longtemps persuadé que je le désirais. En fait, c’est « elle » qui rêvait d’une carrière de chirurgien/prof de fac pour son aîné. Trop long, 10 ans d’études! Je n’ai jamais été assez travailleur pour ça.
Circonvenus par je-ne-sais-quel-couillon, Zalan (compagnon de toutes mes turpitudes d’adolescence) et moi avions décidé que nous voulions faire du Droit.
Le surlendemain du bac – oui car le lendemain, nous étions trop préoccupés à nous remettre de la cuite monumentale ayant suivi l’annonce des résultats – le surlendemain donc, direction la Fac de Droit, dans l’ancienne maternité face à la Cathédrale. Inscription en poche, fallait songer à la suite.
Zalan se fit embaucher comme pion au lycée d’où nous sortions en tant que potaches. Pour moi, pion, pas question! Justy y avait mis un holà féroce, un veto qu’il n’était pas question d’outrepasser: à 18 ans, j’étais mineur. Je trouvai vite la combine hypocrite…
Quelque deux mois après les premières leçons de Droit, le filon se découvrit à moi. Mais que je vous dise deux mots des cours de Droit… J’y rencontrai des gens très bien.
Félix Guyon, tiens, ancien magistrat, petit-neveu du célèbre urologue et prof de droit civil. Il arrivait le matin et embrayait direct là où il avait laissé sa phrase en suspens en nous laissant en plan la veille au soir, virgule comprise (ceci est authentique, parole!)
Il y eut le jeune André Oraison, assistant en droit constitutionnel, celui-là même qui aujourd’hui flanque la gratelle à tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Plus un copain qu’un prof (excellent) ; d’ailleurs, nos chemins se sont parfois croisés dans des endroits que la morale réprouve mais chut!
À côté de ces moments agréables, il y avait de vrais pensums, comme le traité d’Économie politique de Raymond Barre, que devaient se farcir tous les étudiants de France et de Navarre. « Premier économiste de France », disait Giscard. Peut-être. Mais « premier chiant de Fac » certainement.
Comment piquer l’argent des Impôts? Facile!
Pour justifier son interdiction de me laisser devenir pion, Justy argua que cela me prendrait trop de temps sur mes études. C’est alors que M. Grit, notre vénérable prof d’Histoire du Droit (passionnante, l’histoire du Droit… quand on aime ça), également inspecteur des Impôts, nous apprit qu’il dirigeait une formation réservée aux étudiants en Droit, tenez-vous bien: « Élève inspecteur élève des Impôts ». Il y avait de la place pour quatre et la contrainte était simple : on nous payait (en gros 1.000 euros mensuels en valeur actualisée, le super-pied !) pour étudier « en plus », grâce à la Préparation Francis-Lefèvre dont les livres nous seraient fournis par l’administration fiscale. Il nous suffisait, chaque samedi matin, de retrouver M. Grit dans son bureau et lui réciter les leçons apprises durant la semaine. En fin d’année, nous aurions le droit d’aborder le concours des Finances avec départ pour l’école des Impôts en France.
Apprendre ça ou les cours de Droit, la différence était mince et nous fûmes quatre à y aller. Claude Abrahmes, Yves Crochet, Claude K/Bidy et Bibi. Claude voulait réussir au concours d’inspecteur-élève et fut reçu.
Yvon, Claude et moi voulions le fric des Impôts mais pas le concours final. Nous eûmes le fric plusieurs mois durant et échouâmes au concours.
Je ne sais ce qu’est devenu Claude qui conduisait comme un pied une vieille Floride bleu ciel. Si quelqu’un le sait, merci d’avance de me prévenir.
Yves Crochet a eu sa licence en Droit et a effectué une magnifique carrière au sein de la mairie de Saint-Denis.
Moi? J’emmerde tout le monde avec mon clavier.
Pleins à déborder!
Lorsque vous avez été fauché (Michel et moi n’avions que 1.000 francs CFA par mois) et que tout à coup vous vous retrouvez les poches pleines de billets, c’est le vertige. Le vrai vertige.
À notre entrée aux cours de ce bon M. Grit, ce dernier nous avait recommandé de nous faire ouvrir un compte bancaire. Le Trésor public était tout près, rue Amiral-Lacaze, nous nous y ruâmes comme les quatre Cavaliers de l’Apocalypse : nous étions enfin, formellement, dans le monde des grandes personnes. Et lorsque le premier salaire tomba, ouaille-aïe-aïe!
Je ne sais ce que firent mes trois comparses élèves-inspecteurs-élèves mais pour moi, je m’en souviens comme si c’était hier. Tonnerre de Dieu la cuite!
Zalan… évidemment! avec sa paye de pion ; plus quelques autres « turbulents », Marcel Soubou, Thérésien Payet, Ti-Lebon, Marc Bédier, entre autres, et votre serviteur, nous nous retrouvâmes chez Casquette, comme de bien entendu. Ce soir-là, Maxo, le patron, dut jouer les prolongations et ne consentit à nous pousser vers la sortie que lorsque nous fûmes pleins à déborder. De quoi rappeler aux fins connaisseurs une chanson de l’ami Graeme Allwright: « En chantant on marchait à reculons ».
D’ailleurs, ça « déborda » pas mal. Devant chez Casquette même. Mais pensez donc: cela avait commencé par 20 bouchons (chacun) en guise d’apéritif, arrosés de quelques grands verres de Martini sinon de whisky selon les tempéraments. Étant encore modeste alors (hum!), j’avais entamé la descente aux Enfers du plaisir par du Cinzano. Puis des steaks chinois ; puis le riz cantonnais avec shop suey. Et environ une bouteille de Rosé-Napoléon par tête de pipe.
Je ne sais combien de jours nous mîmes à émerger.
Je profitai aussi de cette première paye – tant qu’à faire – pour me payer un blouson de cuir bon marché et ma première mobylette payée de ma poche. Dindar avait alors son magasin croisement Jules-Auber et rue de Grand-Chemin. Avec l’autorisation de Justy, j’y achetai une magnifique Florett grise à cinq vitesses. J’aurais voué mon âme au diable pour posséder un tire-con comme notre idole Choby des Jokarys! L’expression « tire-con » est d’André Desbies, un pote médecin.
Elle ne resta guère longtemps à l’état neuf, comme vous le constaterez dans un instant.
Enfin pion!
À la fin de cette mémorable année, j’échouai à mon examen de Droit comme il fallait s’y attendre. Justy, constatant que je me débrouillais mieux dans la vie active que sur les bancs de la Fac, consentit alors à me laisser devenir pion. J’allais dare-dare présenter mes offres de service à M. Cresta, censeur du vieux lycée Leconte-de-Lisle, et comme il gardait un bon souvenir du bon lycéen approximatif que j’avais été, il signa devant moi son acceptation.
J’étais pion. Hourra!
J’entamais en même temps mon redoublement à la Fac et ma vie de surveillant. D’autorité, M. Savin, surveillant général et type en or, m’installa au service des absences. Boulot simple : le matin, je recevais les absents des jours précédents avec le mot d’excuse de leurs parents. J’enregistrais, je classais et mon boulot était fini ! Une petite heure de boulot. Qui faisait enrager mes collègues comme des tangues en chaleur: eux, ils se payaient des heures et des heures à surveiller les salles de permanence ou les dortoirs, plus les séances au réfectoire et l’ordre dans les cours de divagation (pardon : cours de récréation lycéenne).
Ce qui les faisait râler, c’est que mon salaire était le même que les leurs, c’est-à-dire à peu près deux fois plus qu’aux Impôts! Et les avantages aussi.
J’eus droit à un box au dortoir des pions, au troisième étage du bâtiment principal, juste à côté du 1er dortoir, celui des terminales. Et la possibilité de prendre nos repas au réfectoire des pensionnaires pour un tarif plus que modéré. Mais la jaffe était si mauvaise et nous étions si « riches » que nous préférions Chez-Casquette, le Ti-Couloir ou Chez-Georges. Nous dûmes ainsi, plusieurs fois, « faire le mur », mais en sens inverse: pour rentrer après libations, beuveries, orgies diverses et visites dans quelques recoins mal famés que nous adorions, côté du Butor par exemple. Ce fut souvent périlleux.
Ah! le picol’s dames! Ah!…
Mon travail aux absences me valut parfois quelques inimitiés, avec des « spécialistes » comme Frank F. ou Maxence D., qui apportaient des mots d’excuse faux comme des jetons. Les heures de colle volaient bas.
Zalan et moi avions trouvé un passe-temps très intellectuel : pour ceux que nous envoyions en colle, nous leur imposions des sujets de dissertation tout droit issus de nos cerveaux malfaisants: « Qui a cassé le vase de Soissons? »…
Nous avions également mis sur pied un jeu directement fourni par le commissaire San Antonio, le « picol’s dames ». Un jeu à rendre cinglé Einstein lui-même.
Il faut un damier plus grand que le damier classique, pour supporter les petits verres style « charrette » remplaçant les pions du damier traditionnel. Pour les débutants, c’est vin rouge-vin blanc. Le jeu est le même sauf que lorsqu’on « mange » un pion adverse… on le boit. Et lorsqu’on « souffle » un pion négligé par l’adversaire… on le siffle aussi. Et le gagnant se retrouve dans l’obligation de boire tous les pions/verres qui lui restent.
Inutile de dire que le gagnant de la première partie est à peu près sûr de perdre la seconde. Pour la « belle », c’est au plus résistant.
Les joueurs les plus aguerris remplacent les vins bi-colores par du charrette/bourbognac. À cause des couleurs, vous suivez? En début de mois, quand la paye tombait, au lieu de rhum/bourbognac, on s’amusait à tester le vodka/calvados. Sinon le gin/armagnac.
Un soir, M. Savin débarqua au beau milieu d’une partie, on faillit fondre de désespoir. Mais le brave homme eut juste un sourire intéressé, nous souhaita « bonne continuation » et s’en alla comme il était venu. Des supérieurs comme ça, on n’en fait plus.
Claude Luter et Maxime Saury à la Fac!
Un soir, la porte du dortoir des grands étant restée ouverte par une inadvertance de Gopal, le gardien de nuit, nous allâmes défier les pensionnaires en combat singulier… bataille de polochons. D’un côté Zalan, Jean-Yves Grondin, « Paysan » Maxime Boyer et moi. De l’autre une dizaine de lycéens avides de cogner sans risque sur des pions.
Leur souci fut de ne pas être assez délurés pour taper vraiment. On leur a mis plein la tronche pour pas un rond. Mais le tout avec de grands éclats de rire de part et d’autre.
Je crois que Jean-Yves est parti très tôt habiter en Australie, comme l’ami Loïs Payet. Si quelqu’un a l’adresse de Jean-Yves, please!
Un souvenir merveilleux resurgit comme ça… À la fin de ma première année de Droit, j’avais laissé le poste de Président de la FER (fédération des étudiants réunionnais) à Philippe Rivière, qui eut une idée extraordinaire: pour le bal de fin d’année, il fit venir Claude Luter et son orchestre, avec Maxime Saury. Les deux grandes vedettes françaises du jazz New-Orleans.
Quelle soirée, les enfants. Quelle soirée. Nous eûmes droit à tous les standards du meilleur du jazz français, avec un savant mix de New-Orleans et de blues. Ces musiciens, d’une fabuleuse gentillesse, furent si heureux de l’accueil que nous leur fîmes, qu’ils jouèrent jusqu’à quatre heures du matin! À la fin de leur prestation, ils invitèrent Alain Bastide à monter sur scène avec sa guitare Gretsch Chet Atkins. Nous eûmes droit à un des plus beaux « When the saints » que j’ai jamais connus!
Cerise sur le gâteau, lorsque les professionnels partirent, ils laissèrent leurs instruments et amplis sur place. L’occasion était trop belle de montrer ce que l’on savait ; nous montâmes sur l’estrade à notre tour. Jean-Marc Bédier (future très belle carrière préfectorale) prit la batterie. D’autres les guitares accompagnement et basse tandis que j’empoignais une Eko pailletée à quatre micros et vas-y que je te massacre les Shadows, les Fingers, les Jumping Jewels. Les copines de la Fac nous admiraient, c’était l’essentiel. J’ai retenu le nom (et la silhouette) de quelques-unes d’entre elles : la fille de Peter Boy (traduisez Pierre Garçon, prof d’anglais) ; l’ensorcelante Annick Ramsamy, fille de sénateur ; Huguette F. ; la douce Anne Quirin, fille de procureur ; Sylvie Goy, égérie de la bande à Truffaut venue tourner « La sirène »…
Un vol plané de toute beauté!
Je dois confesser que ces années-là, grisé par le pognon tout neuf, je passai plus de temps à jouer de la guitare qu’approfondir mes cours de droit administratif.
Je hantais plus les parages de l’église Saint-Jacques que de la Cathédrale. C’est dans ce coin qu’habitaient Joël Dupont, Jean-Marc Boyer, Michel Langlade, Georges Rochetams « OSS-117 », autrement dit les Faucons, un des tout meilleurs orchestres de guitares électriques de l’île, drivé par Jean-Marc, soliste aussi comique qu’efficace.
Ou alors, nous traînions nos guêtres vers la rue du Bois-de-Nèfles, du côté des glorieux Torpilleurs: le grand François Saint-Alme, le génial Denis Gagneur, très fin bassiste de très grande classe (classe musicale, classe morale, classe physique), le très véloce et inventif Jean-Claude Maître…
C’est aussi vers cette époque que je réduisis ma Florett à l’état de bois d’allumettes.
Un dimanche que nous étions à Cilaos, Zalan et moi, nous nous lançâmes un défi à la con : partir de l’entrée du village, lui sur sa Vespa Piaggio, moi sur ma Florett, savoir qui arriverait le premier devant Notre-Dame-des-Neiges. C’est malin, non? C’est parti!
Nous nous élançâmes du bas du village, devant la villa « Mirella » de Pierrot Malet. Roue dans roue, poignée dans le coin, nous dévalâmes la rue du Père-Boiteau, faisant fuir comme moineaux dans l’coup d’vent tout ce qui avait deux ou quatre pattes. Parvenus devant l’église, je ne sais ce qui nous prit. Zalan crut que je continuais vers le Grand-Hôtel alors que moi je voulais finir en beauté devant le parvis de l’église.
Ça, pour finir en beauté, nous finîmes en beauté.
Nous nous heurtâmes pile là où un embranchement file vers le Grand-Hôtel et l’autre monte vers Notre-Dame-des-Neiges.
Sa Vespa partit vers l’église, ma Florett vers la droite.
Zalan partit vers la droite et moi vers la gauche. Ce qui fait que nous nous croisâmes en l’air, en un vol plané de toute beauté.
La Vespa, monstre de solidité, s’en tira sans grand dommage: il fallut juste faire faire un tour complet au guidon pour le remettre dans le bon sens. Ma Florett, plus exactement ses miettes éparses ici et là, n’avait plus, d’engin motorisé, que le nom. Nous-mêmes? Quelques éraflures peu dignes du Guinness of records.
Doit y avoir un dieu pour les amateurs de jus de fruits.