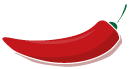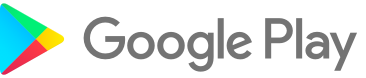Pas de télé, une radio émettant 3 heures par jour, internet encore à inventer, pas de PS, ni en jeu ni en politique… Heureusement que notre imagination n’a jamais pu être prise en défaut en ces époques où on ne comptait vraiment que sur soi-même et les potes. Pour s’amuser, y’a jamais eu de lézard car l’imagination fonctionnait à la puissance 1.000.
Marelle et « ti-l’autos roulement à billes »
« Quand nous jouions à la marelle,
Cerisiers roses et pommiers blancs… »
De tous les jeux passionnant nos copines, il y eut de tout temps la marelle, connue dans le monde entier, auquel, nous les garçons, ne comprenions goutte. Mais nous regardions néanmoins ces demoiselles sauter, rire, faire leurs entrechats, jupes virevoltant au vent. Ces « terre », « ciel » et autres inscriptions cabalistiques dans une vague croix à carreaux tracée à la craie, nous emplissaient de perplexité. Elles pouvaient s’y adonner des matinées entières sans paraître fatiguées, le bout des semelles élimé par les sauts à répétition. Après avoir essayé et nous être emplafonnés deux ou trois fois, nous y renoncions bien volontiers, la mine piteuse sous les regards narquois de nos amies.
Pour nous venger de cette humiliation et recouvrer notre mâle prestige, nous fabriquions des « l’autos roulement à billes ». C’était quelque chose !
Il suffisait juste de dégotter quatre roulements à billes (environ 10 centimètres de diamètre). On en trouvait à profusion dans les carcasses de voitures désossées achevant de rouiller ici et là. Et trois planches assez solides pour supporter le poids des gars… les gades à répétition. La plus grande planche servait de siège à ras de terre ; des deux autres, transversales, l’une était fixe, à l’arrière ; la seconde, à l’avant, était mobile et se maniait par les pieds. Les roulements à billes étaient au bout des deux planchettes transversales. Pas de freins, pas de guidon, pas de garde-fou : on s’asseyait le cul à dix centimètres du sol, on plaçait les pieds sur la planchette avant et un copain donnait l’impulsion en poussant fortement le « pilote » par les épaules. Du haut d’une pente de bon aloi, comme bien on pense.
Pour nous, à La Rivière, le « déboulage » commençait en haut de la Pente-Nicole pour se terminer, dans le meilleur des cas, dans le baro de Fritz Lebreton ou de la boutique Piong-Siong. Où nous étions fort mal reçus, vous pensez bien. Mais les plus chanceux, par un sens du pilotage hors du commun et un goût morbide du trompe-la-mort, arrivaient parfois à atteindre les portes du cinéma Concorde, juste avant l’église. cinq cents mètres loin en bas-là-bas… Mais là, par manque de système de freinage, ça finissait généralement très-très mal : vêtements déchirés, horions, plaies, bosses, « brossages » divers sur le macadam, coudes et genoux « grafinés » par le macadam… quand ce n’était pas le menton.
Inutile de dire que ça n’était pas tant les « boubous » (qui utilise encore ce vieux vocable pas vraiment médical ?) qui mettaient nos parents en transe, mais les vêtements bons à faire de la charpie. Distribution générale de fouèttes pêche, « bloucs ceinturon » et autres tapins.
Cadoque et canettes
Autre jeu où ces demoiselles nous battaient à plate couture, le « cadoque ». Cela se pratiquait avec des noix soigneusement débarrassées de leurs aspérités internes et des graines de maïs, de « bibi jacquot », sinon des noyaux de « zambrosade ». Dame Nature nous a toujours prêté une collaboration affectueuse. Heureusement.
La joueuse s’asseyait à croupetons, les noix posées par terre devant elle. Le noyau ou la graine de maïs étaient installés par terre entre les coques. La joueuse s’emparait prestement du noyau de zambrosade et le jetait en l’air ; puis saisissait une des noix et, la retournant, tentait d’y réceptionner le projectile. Certaines de nos copines s’y révélaient d’une habileté diabolique. Le défi, pour les meilleures, consistait à expédier vers le ciel le plus de noyaux possible et de les recueillir avec deux ou trois noix à la fois.
Elles devaient avoir l’oeil très affûté car je ne me souviens pas que nous, les garçons, ayons pu une seule fois les battre à ce jeu moins simple qu’il n’y paraissait. Il est totalement passé de mode mais selon mes souvenirs, il réclamait autant sinon plus de rapidité que n’importe quelle play station !
Alors, nous les garçons revenions bien vite à nos canettes ! Les billes, pour les non-initiés à une langue créole bien comprise. Les canettes avaient un inconvénient, et de taille : il fallait les acheter. Ah-Ton, Ah-Vi ou « Chinois-Neuve » en faisaient toujours venir une petite provision chaque année et s’efforçaient de ne pas les commercialiser trop cher mais n’empêche… nous étions fauchés. Alors, toujours l’imagination au pouvoir, nous avions créolisé les billes d’agate en les remplaçant par des capsules. Ce qui impliquait également que les règles du jeu soient quelque peu différentes.
« Jouer boutons », « daille »… et tapins à suivre
Les capsules de bouteilles, on en trouvait partout « dan’ canal » ou devant les boutiques. On s’en emplissait les poches en attendant l’heure de la récré. La règle était simple : chaque joueur avait le même nombre de capsules. Une ligne était tracée au sol et, à trois mètres de là, on creusait un petit trou. Chacun envoyait ses capsules le plus près possible du trou. Comment faisions-nous pour les distinguer ? Mystère ! Celui qui était le plus près du trou expédiait ses capsules une à une, d’une pichenette, dans le trou. Puis le plus proche suivant, et ainsi de suite. Celui qui avait le plus de capsules dans le trou empochait les capsules des copains.
Le trou s’appelait aussi « le but », ce qui a donné logiquement à ce jeu le nom de « jouer butter ».
On finissait bien par se lasser des capsules, trop faciles à trouver. Ce qui fait que nos esprits démoniaques avaient trouvé de quoi rendre la chose plus palpitante : « jouer bouton ».
Cela consistait tout simplement à arracher deux ou trois boutons à ses propres vêtements et s’en servir en guise de « capsules ». Les parents des gagnants étaient tout heureux de renforcer les avoirs vestimentaires familiaux ; plus besoin d’acheter des boutons. Mais pour les parents des perdants, c’était, si j’ose dire, une autre paire de manches… sans boutons !
Le soir, en rentrant, c’était la traditionnelle correction, fouèttes pêche, tapins etc.
Je ne citerai que pour mémoire les « loup couru », « loup cachette », balançoires (bricolées, évidemment) et autres « ballon prisonnier », toujours pratiqués de nos jours.
Je ne sais quand, ni par qui, a été inventée la version créole des Petits chevaux. Ça s’appelle « daille ».
On traçait sur le ciment un parcours exactement semblable à l’autre mais en guise de chevaux, les joueurs utilisaient des graines : haricots noirs, maïs, gros pois, zantaques, le compte y était. En guise de dés, que nous ne possédions pas, nous prenions six graines de haricots rouges dont un des côtés était frotté jusqu’à devenir blanc. On agitait les six à la fois et le nombre de côtés blancs virés vers le haut déterminait le nombre de cases à avancer.
Simple, non ? L’avantage était de pouvoir être pratiqué garçons et filles confondus.
Le diabolique « jouer suiv’ »
Un jeu diabolique auquel seuls les garçons s’adonnaient, pour cause de distribution de gnons assurée, c’était « jouer suiv’ » (suivre). Cela m’a été raconté par un vieil ami hélas disparu, Albert Élie. Il s’y adonnait avec ses potes dionysiens, sur le coup de ses 12-15 ans, dans les années 50 à Saint-Denis.
« Jouer suiv’ » consistait à choisir un chef de file et tout faire exactement comme lui, quelque fût ce dont il s’agissait. Par exemple, le chef arrivait devant chez un brave Zarabe appuyé à la porte de son magasin et demandait, l’air innocent : « Hein, monsieur, ou néna boutons la toile kaki ? »
Ce qui n’existait évidemment pas.
• Non ! Na point ça ici, répliquait gentiment le brave Zarabe en souriant. Mais au fur et à mesure, son sourire se transformait en grimace rageuse car tous les autres petits enfoirés, à tour de rôle : « Hein, monsieur, ou néna boutons la toile kaki ? »
Une fois, ça allait. Deux fois, ça allait encore. Mais au bout de la dixième fois, le commerçant pétait les plombs : « La di à zot na point, bande baise zot momon ! »
Mieux valait se trisser vite fait.
Si un grand tenait la place de chef, il s’amusait souvent à sauter par-dessus un obstacle difficilement franchissable pour les plus petits, pied d’galabert, grosse roche… Cela finissait, comme les histoires d’amour, mal en général. Bagarres, plaies, gnons, coups d’zoc, maille cal etc.
32-Dumas, Opinel ou sabre-à-cannes ?
Autre jeu commun aux filles et aux garçons, « casse-couteaux ». Pour ça, nous attendions les vacances d’août à « Village » (Étang-Salé-les-Bains). Planter des couteaux dans le sable est quand même plus gratifiant que dans la terre dure.
Cela se passait généralement l’après-midi, juste après le déjeuner. On s’asseyait en rond sur la plage, peu importe le nombre. Il y avait toujours deux ou trois couteaux bien affûtés subtilisés dans les cuisines familiales à l’insu des parents. Nous choisissions des couteaux très pointus mais surtout assez lourds pour supporter les exercices auxquels nous les destinions.
Certains se distinguaient en apportant le 32-Dumas du papa, l’Opinel du tonton, sinon le Laguiole préféré de maman. Un jour, l’un de nous, Alfred Rivière je crois (le fils de Clé, je vous ai déjà parlé de lui dans un précédent article), a tenté l’aventure avec un sabre à cannes. Après se l’être planté dans le pied (légèrement, je vous rassure), il n’a pas réitéré sa turpitude.
À tour de rôle, chacun prenait le couteau, le but étant de le planter dans le sable après une figure plus ou moins acrobatique. Par exemple, on mettait la pointe de l’arme dans la main gauche, on posait la droite sur le haut du manche et on faisait pratiquer au couteau un magnifique salto avant en le dirigeant vers le sable. Où il devait rester planté.
Ça, c’était la figure la plus simple. Nous inventions toutes sortes de combines, couteau placé à plat sur le poing retourné, lancer à la Davy Crockett, lancer de la main gauche pour les droitiers, lancer « apache »… Demandez la signification à vos tontons. Les menus incidents de tir n’étaient pas rares. Les concurrents étaient alors en joie devant la petite perle de sang sur l’orteil ou le cou-de-pied ; les parents beaucoup moins.
Filles ou garçons, qui étaient les plus habiles à ce jeu ? Cette redoutable question existentielle n’a jamais pu trouver de réponse.
Saison toupies… saison ceinture »
Si nous n’avons jamais tenté d’égaler nos copines dans la fabrication de « babas-chiffons », elles n’ont jamais essayé de rivaliser à la toupie.
Pour celle-ci, il y avait déjà le modèle traditionnel, acheté chez le Chinois du coin. Il y en avait de toutes les tailles ; nous préférions les plus petites, qui vrombissaient le mieux en tourbillonnant.
Mais il eût été trop simple de l’utiliser telle quelle !
On commençait par couper la petite tête ronde de l’engin. Puis on arrachait « le naille » (le clou) pour le remplacer par un « vrai » clou, long, mince, sur lequel la ficelle s’enroulait mieux. Il eût également été trop facile de juste faire tourner la toupie : par tirage au sort, l’un faisait tourner sa toupie et l’autre devait lancer la sienne exactement sur la tête de la première. Les plus habiles, plus forts aussi parvenaient à faire exploser la première toupie en pleine action. Cela vous forgeait une réputation redoutable pour l’éternité.
Lorsque nos poches étaient trop vides pour aller à la boutique, nous nous rattrapions comme nous pouvions. Une varangue bien ronde et très verte faisait une excellente toupie.
Mais rien ne valait bien sûr les grains d’letchis ! Nous les choisissions bien ovales, bien gros, on leur enfonçait une demi-allumette dans la partie blanche de leur anatomie et roulez jeunesse !
Nous avions ainsi « des saisons », « saison capsules, saison boutons, saison toupies » ; et « saison ceinture ». Ah, la saison ceinture ! Un jeu d’une finesse, d’une spiritualité sans pareille.
Cela se passait dans la cour de récré. Par tirage au sort, l’un de nous (« le maire ») était chargé d’aller dissimuler dans une anfractuosité (il y en avait beaucoup au mur du préau) une ceinture en cuir bien épais. Les autres avaient interdiction formelle de regarder sous peine d’exclusion définitive. L’objet étant caché, « le maire » tapait dans ses mains, ce qui était le signal de la chasse au trésor pour les autres. Ces derniers farfouillaient tous les coins et recoins de la cour de récré jusqu’à ce que l’un mette la main sur le corps de la quête.
Là se révélait toute la finesse du jeu : celui qui avait trouvé la ceinture avait le droit de l’utiliser… pour poursuivre les autres jusqu’à une ligne de démarcation admise par tous. En leur « suifant » les fesses à grands coups de cuir. Et le possesseur de la ceinture n’y allait JAMAIS de main-morte, croyez-moi.
Comme disent Achille Talon et Hilarion Lefuneste, détruisant les sonnettes de leurs voisins : « Les joies de l’esprit sont tout-de-même les plus belles ».
Ballons pamplemousse
La recherche de produits de remplacement pour cause de pénurie d’argent, ne s’exerçait pas uniquement pour les toupies. Le foot aussi.
Vous imaginez aisément que nous n’avions jamais les moyens d’acheter un vrai ballon de foot. Certains se sont bien essayés à en piquer un ou deux chez les joueurs affirmés. Comme à la Saint-Louisienne. Mais vieux Balbolia té que navé in mauvais coup d’pied ! Alors, on se dém…dait.
On pouvait ainsi utiliser un bon gros pamplemousse bien vert, bien dur, qu’on attendrissait vaguement en le plongeant durant quelques heures dans le « manger cochon ». Un peu ramolli, il faisait un ballon très acceptable… sauf que nos orteils étaient d’un avis totalement opposé car même bouilli, le pamplemousse est de mauvaise composition. « Plaf ! Plaf ! » entendait-on ainsi assez souvent. Suivi d’un sonore « Ouaille ! Totoche ton tantine ! » Ce qui signifiait sans coup férir qu’un gros orteil venait de payer son tribut au pamplemousse rétif.
Moins méchants étaient nos « ballons-chiffons ». On compressait vaille que vaille tous les vieux bouts de tissu, quelques feuilles de carton détrempées, on leur donnait une forme vaguement ronde, on assurait le tout « èk in gature choka » et vogue la galère.
En ces époques bénies, nous n’étions guère douillets. Jordu, in marmaille i gaingn in coup d’cogne, i rente l’hôpital. Je me souviens d’un copain, Georges peut-être, à moins que ce ne fût son frère Élie. C’était après un « Plaf ! Ouaille ! Languètte out’ momon » de bonne facture. Nous le vîmes examiner l’ongle de son gros orteil qui venait de se désolidariser de la chair mais tenait encore en place.
Foin de toute mièvrerie ! Il saisit le bout de l’ongle en voie d’indépendance, l’arracha d’un coup sec. Puis il s’empara de quelque vieux chiffon trainant dans le coin, bien sale, bien poussiéreux, s’en fit un bandage et… termina sa partie de foot.
Ça caractère, ça baya !
Les marches de l’église à vélo, c’est quékchose !
J’ai déjà raconté autre part comment on « jouait la guerre », c’est-à-dire aux cow-boys et aux Indiens ; je n’y reviendrai donc pas. Je préfère vous raconter (mais ne me vouez pas aux Enfers, please !) comment nos esprits débridés s’arrangeaient pour ne jamais pêcher par ennui.
Lorsque nous voulions « jouer l’école », par exemple, il n’était pas question d’utiliser les vrais cahiers et les vrais crayons, déjà bien assez chers comme ça. On se servait alors de feuilles de plantes grasses comme celles de baume-du-Pérou ou, mieux, de raquettes de choka en guise de cahiers. Pour écrire ? Facile ! Des épines de choka, cela va de soi. Ça marchait du feu de Dieu.
Mais il y avait mille fois mieux en guise de coups pendables. Ainsi lorsque nous eûmes des vélos. Le chic était de se positionner en haut du parvis de l’église Notre-Dame-du-Rosaire la belle. En contrebas, il y avait plusieurs volées de marches successives entre lesquelles serpentait la route… et quelques voitures. On écoutait attentivement, souffle retenu, jusqu’à être certain qu’aucun véhicule n’approchait. On s’élançait alors… première volée de marches… la cour de l’église… deuxième volée de marches… traversée de la route… volée de marches… autre cour… les marches… la route (elle serpentait, la drôlesse)… il y en avait encore deux comme ça. On terminait ce parcours ahurissant généralement en s’encastrant dans la porte d’entrée de la cure. Le père Colette n’appréciait que très modérément.
Pauvres caméléons !
Nous étions des monstres car…
Quelqu’un vous a certainement parlé de « la pêche camaléon », je suppose ?
« Néna trois jours-quat’ nuits
Son papa la rôde à li
La trouve à li quat’ pattes
Dans la pêche camaléon… »
Cette chanson, contrairement à ce que prétendent les sous-titres des disques, a été malicieusement composée par Loulou Pitou et joyeusement interprétée par Benoîte Boulard. Je ne vais pas ici vous expliquer le pourquoi du comment de ces paroles à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Pour nous, « la pêche camaléon » était une toute autre affaire. Monstrueuse, il faut bien le dire.
On fabriquait un petit lasso au moyen d’une tige de « z’herbe dur », sorte de chiendent très solide. On assurait ce lasso-maison au bout d’une branche de gouyave, les plus solides, et on approchait du caméléon se chauffant au soleil avec des prudences de Sioux sur le Sentier de la guerre. On lui passait le noeud coulant autour du cou en essayant de ne pas réveiller l’innocente bestiole, on tirait d’un coup sec et hop ! Sire caméléon se retrouvait à gigoter ridiculement au bout de sa tige z’herbe dure.
On pouvait rester un temps infini à contempler la proie se déhanchant grotesquement dans le vide… mais son cauchemar n’était pas terminé.
L’un de nous avait entretemps dégotté un mégot sur le bord de la route. On allumait le mégot, on le glissait entre les mandibules du caméléon en évitant de se faire mordre et on posait l’animal au sol. Vraiment monstrueux… Car le caméléon avale la fumée mais ne la recrache pas. Il enflait, enflait, jusqu’à exploser, pour la plus grande joie des petits salauds que nous étions. Les Inquisiteurs n’ont jamais trouvé mieux en fait de torture rigolote !
Bon ! Bon ! ça va, tirez pas !
Mais je vais quand même vous dire que c’était bien plus marrant avec les crapauds… Car les crapauds continuaient de bondir en avalant la fumée. Pour finir par exploser en plein vol. Encore plus tordant en se servant d’un pétard Jour d’l’An en lieu et place de mégot. Le bruit, vous comprenez ?
Un dernier détail. Nous n’étions pas que des brutes anti-écologiques. Il nous arriva, en grandissant (en âge mais guère en sagesse, je le crains), de nous livrer à des jeux plus sophistiqués. Comme le « jeu du Baccalauréat » par exemple.
À cet exercice, il me revient que Zalan fut toujours le plus fort.
Bon, cette fois, je sors comme dirait qui vous savez. =====>