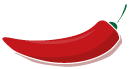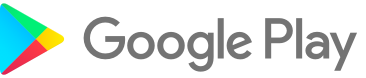[Lire aussi : 50 ans de l’INSEE : La Réunion en 1966, c’était comment ?]urlblank:http://www.zinfos974.com/50-ans-de-l-INSEE-La-Reunion-en-1966-c-etait-comment_a105934.html
En quelle année êtes-vous arrivé à la Réunion ?
Charles Durand : Cela s’est fait par pur hasard du calendrier. Je suis arrivé à La Réunion le 14 décembre 1965 pour faire mon service militaire à la base. Les deux VAT (volontaires à l’aide technique, ndlr) qui m’avaient précédé et qui étaient dans une structure préfectorale de statistiques venaient de partir et j’ai pris leur place. Comme j’étais attaché de l’INSEE, on m’a tout logiquement muté dans les services de la structure dans l’île. Les choses m’ont été présentées de la sorte au départ. Mais quand je suis arrivé à Gillot, un collègue qui venait d’arriver dans l’île pour une mission sur les conditions de vie des ménages en milieu rural m’avait appris que c’était moi qui allait monter l’INSEE Réunion. Je pensais que j’arrivais dans une structure avec déjà 40 ou 50 personnes et là ça m’est tombé dessus et l’INSEE Réunion a été créée le 1er janvier 1966.
Par chance, ce même collègue venait de créer le service de l’INSEE en Martinique et avait de ce fait une certaine expérience des choses, contrairement à moi qui venait de sortir de l’école de statistiques. Créer un service de statistiques n’est pas que cela : c’est beaucoup d’organisation avec le recrutement du personnel, de la comptabilité publique, de la relation avec d’autres organismes…Bref des choses que l’on n’apprend pas à l’école de statistiques. J’avais également tout à apprendre d’un point de vue organisationnel, tout comme mes jeunes collègues réunionnais, qui avaient tout à apprendre de la statistique.
Vous êtes arrivé à La Réunion pour quelle mission initiale et qui vous en a donné l’ordre ? Le Préfet de l’époque, le ministère de l’Économie ou encore le Premier ministre ?
C’est une lettre du ministère des DOM-TOM qui me met en tant que militaire du contingent à disposition du Préfet pour monter un service. D’un autre côté, j’étais en relation avec la direction générale de l’INSEE qui avait commencé à donner des crédits spécifiques pour monter le service.
Je ne pensais pas rester aussi longtemps je dois l’avouer. Moi au départ, je souhaitais faire mon service militaire et rentrer dans mes foyers pour me rapprocher de mes parents à Nancy. Mais assez vite, après mon arrivée à La Réunion, j’ai eu le coup de foudre pour cette île et j’ai tout fait pour rester. Je venais de passer 10 ans en métropole et bien que je sois né à Paris, j’avais passé une partie de ma jeunesse en Afrique du Nord et la métropole ne m’avais jamais ‘branché’. Quand je suis arrivé ici, j’ai eu comme un flash : je revois le Barachois avec les flamboyants en fleurs, c’est autre chose que la grisaille parisienne. Et puis très vite je me suis trouvé beaucoup d’affinités avec la population et les collègues. J’ai beaucoup voyagé dans ma vie et en toute objectivité, c’est à La Réunion où je me suis senti accepté et où je suis revenu en 2002 lors de ma retraite.
Comment devient-on directeur de l’INSEE Réunion alors que l’on n’a que 25 ans et que l’on est venu qu’en tant que simple VAT ?
Par une pure coïncidence : il n’y a pas eu d’appels d’offres ni rien du tout. D’ailleurs en septembre 1965, il était question que j’aille en Martinique.
Vous aviez reçu quelle lettre de mission ?
Une de mes premières prérogatives a été de recruter du personnel mais aussi de trouver un local autonome. Il faut savoir qu’à l’époque, les services antérieurs à l’INSEE étaient logés dans les locaux de la Préfecture. L’INSEE a tenu à ce que très vite on occupe un local à nos frais afin de ne pas dépendre de la Préfecture du point de vue matériel. C’est ainsi qu’on a déménagé au 95 rue Jules Auber le 1er juillet 1966.
La personne qui m’a accueilli était venue faire une enquête sur les dépenses des ménages en milieu rural, pour évaluer un peu le niveau de vie de la population. Mais les deux VAT qui m’avaient précédé avaient mené une étude sur le budget des ménages à Saint-Denis, qui servait à l’époque à asseoir l’indice des prix. Une de mes premières activités en 1966 a donc été de mettre en place le nouvel indice de prix. À l’époque, la Préfecture avait calculé un indice avec 12 articles qui n’étaient plus représentatifs de la consommation locale. Pour l’anecdote, ils relevaient encore le prix du casque colonial, qui n’était plus porté par personne…(rires).
Tout était à construire ? Sentiez-vous une certaine écoute depuis Paris face à vos difficultés rencontrées sur place ?
L’écoute se faisait de manière différée parce que nous avions de gros soucis techniques avec le téléphone, qui coûtait également très cher. Les communications avec Paris étaient difficiles : c’étaient des communications radios où il fallait parler puis écouter la réponse et ainsi de suite… On communiquait surtout par courrier postal, avec ses inconvénients : ce n’est pas un mail que l’on envoie et que l’on reçoit dans la foulée. Là, c’était sur deux semaines : 8 jours pour que la lettre arrive et 8 autres jours pour que la demande soit traitée. Il y avait malgré tout une certaine souplesse car nous étions relativement autonomes vis-à-vis de la direction nationale de l’INSEE à Paris. De nos jours tout est connecté et dès que quelqu’un fait un geste ici, c’est connu à Paris.
De plus, à l’époque, on fonctionnait beaucoup avec les crédits du Fonds d’investissement des DOM (FIDOM). Un jour, nous avions reçu une lettre de la part du chef de la division des DOM-TOM à Paris dans laquelle il nous octroyait cinq millions de francs CFA pour réaliser une enquête sur l’emploi. De nos jours c’est inimaginable de procéder de la sorte.
Quelle a été la priorité des statisticiens à l’époque? Recenser la population ?
La première priorité pour l’INSEE Réunion fut l’indice de prix avec les enquêtes ménages et les relevés de prix. Et puis après, dès 1967, nous avons débuté les enquêtes sur l’emploi. On ne peut parler déjà de chômage puisqu’il n’y avait pas encore d’indemnisations mais il y avait un sous-emploi des gens. Ces derniers, pour s’en sortir, travaillaient au noir. L’une des priorités de l’INSEE a donc été de mesurer ce sous-emploi. Comme à l’époque l’emploi était très dépendant de la coupe de la canne, on avait fait deux enquêtes : une en mai 1967 et l’autre en octobre de la même année.
Très vite est venu le recensement de la population qui était une opération énorme : il y avait 416.000 habitants à l’époque mais les moyens de communication intérieure étaient beaucoup moins faciles qu’aujourd’hui avec des routes peu praticables et un habitat très dispersé. A tel point qu’à l’époque on avait procédé en deux temps avec tout d’abord un pré-recensement un mois avant pour repérer où étaient situées les cases et ensuite le recensement à proprement parler qui s’est fait à un jour donné (le 16 octobre 1967, ndlr). Il fallait se déplacer dans toutes les communes, recruter des recenseurs et les former. Durant ses cinq-dix premières années, l’INSEE Réunion a surtout fonctionné grâce au recrutement local de vacataires en contrats privés et de ces fameux VAT.
Quelle est la situation démographique lors de votre arrivée à La Réunion ?
On était en pleine transition démographique : on avait réussi avec des actions sanitaires à faire baisser considérablement le taux de mortalité. Par contre le taux de natalité restait très élevé et je me souviens d’ailleurs d’une étude, hors-INSEE, qui estimait que si on laissait les choses se faire, il y aurait eu un million d’habitants à La Réunion en 1985. Les responsables politiques nationaux ont donc pris un certain nombre de mesures pour faire baisser la natalité en développant le planning familial mais aussi en appuyant sur le levier migration, avec la mise en place du BUMIDOM, sans parler des enfants de la Creuse, bien caché par les autorités à cette époque.
Comment se sont organisées les toutes premières enquêtes ?
Nous ne faisions que du porte-à-porte car les moyens téléphoniques ou postaux n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui.
Vous aviez combien de personnes sous votre direction ?
J’ai commencé avec cinq agents et lors de mon départ en 1985, nous étions 45. Actuellement ils sont près d’une centaine. La question n’est pas tellement le nombre mais surtout la structure. Sur mes 45 agents, j’avais quatre cadres A et 5 ou 6 cadres B et le reste c’était du personnel d’exécution. Aujourd’hui, cela s’est complètement renversé : on a beaucoup moins besoin de personnel d’exécution puisque de nombreuses tâches sont désormais informatisées.
Quel était l’accueil des Réunionnais lorsqu’ils étaient sollicités pour des enquêtes ?
Jusqu’à mon départ, La Réunion était considérée comme un endroit idéal pour faire des enquêtes car l’accueil des Réunionnais était bon par rapport à ce qui se passait ailleurs. Maintenant, cela a quelque peu changé, avec l’augmentation de l’insécurité : il y a des barrières et des digicodes partout…
Quelle a été votre première impression de la situation à la Réunion ?
Ma première impression lors de mon arrivée était un peu sinistre : il faisait nuit, les rues n’étaient pas éclairées du tout et pratiquement personne dans les rues, la ville était complètement éteinte. Le lendemain par contre, c’était une explosion de couleurs avec les flamboyants en fleurs sur le Barachois, la mer d’un bleu profond, la gorge de la Rivière Saint-Denis d’un vert très foncé…C’était le coup de foudre avec la lumière !
Je suis resté un an là-bas avant de partir à l’étranger, au Zaïre (désormais République Démocratique du Congo, ndlr) où je suis devenu patron de la statistique. C’était une autre planète là-bas avec le régime de Mobutu. J’avais carte blanche mais aucun moyens…J’y suis resté deux ans avant de partir en Polynésie française. Là-bas aussi j’avais été convoqué par le directeur de cabinet du ministre des Finances qui m’avait menacé de me mettre dans le premier avion si je ne modifiais pas l’indice de prix. Je lui ai répondu que ma famille était prête car moi je ne marchais pas comme ça. Ma réponse l’avait quelque peu déstabilisé, ce dernier n’ayant pas l’habitude de voir un fonctionnaire avec du répondant. Après la Polynésie je me suis retrouvé à Bordeaux avant de finir ma carrière à Paris, où je suis devenu coordonnateur de l’action régionale sur la métropole et les DOM. Depuis 2002, je suis revenu vivre ici avec ma femme Réunionnaise, dans le village du Brûlé où j’ai toujours gardé ma petite case depuis les années 60 et où persiste un certain charme lontan qui s’est perdu au fil des années.
Que vous inspire La Réunion d’aujourd’hui ?
Un peu d’inquiétude…Il y a toujours le risque d’une explosion sociale. J’ai vu celle de mai 1973 au Chaudron. Il y a des inégalités qui persistent voire même qui s’amplifient d’où une certaine tension palpable dans la société.
Le terme qui revient souvent lorsque l’on évoque cette époque, c’est la pauvreté. Est-ce le qualificatif que vous retenez aussi ?
Non, je n’ai pas eu cette impression de pauvreté, mais de calme et de sérénité au contraire. La Réunion était sereine : les gens étaient calmes, gentils, aucune agressivité. Hormis quelques familles qui vivaient aisément, la plupart des gens étaient dans le même bateau. Socialement on avait l’impression que les gens avaient leur place et la cohésion sociale plus importante que maintenant. Il faut dire aussi qu’en termes de consommation, il n’y avait pas grand chose : beaucoup de Réunionnais n’imaginaient pas qu’ils allaient avoir un jour une voiture ou un téléphone par exemple. À l’époque, le fait de pouvoir se loger et que le logement tienne pendant le cyclone n’était déjà pas mal pour une bonne partie d’entre eux. Il y avait également tout un système hors-banque avec les fameux carnets dans les boutik chinois.
Dans ces années là, la plus grande surface de l’île était le Monoprix de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis, sinon ce n’était que des boutik chinois partout.
Et puis l’ambiance politique était assez étrange puisque La Réunion sortait de plusieurs années de ‘règne’ du Préfet Perreau-Pradier, envoyé dans l’île pour ‘éradiquer’ le PCR et la liberté d’expression n’était pas à la mode. Les fonctionnaires et encore plus les militaires comme moi avions une sorte d’épée de Damoclès au-dessus de nos têtes avec l’ordonnance Debré de 1960 qui n’a été abrogée qu’en 1972.
La fameuse politique de « rattrapage » a-t-elle porté ses fruits selon vous ?
Au moment de la départementalisation, la scolarisation à La Réunion était très faible et il y avait beaucoup à faire et pour des raisons de gestion publique et comptable, on n’a pas mis les moyens du tout. C’est-à-dire qu’on a commencé à faire venir le moins possible d’enseignants de métropole parce que cela coûtait trop cher de faire venir des fonctionnaires qualifiés. Au contraire, on a beaucoup recruté et comme il en fallait beaucoup, il y a eu quand même pas mal d’enseignants de l’époque qui n’avaient pas les compétences nécessaires pour enseigner. Attention, il y avait des gens qui possédaient un talent pédagogique certain et qui ont pu être excellents voire même meilleurs que des gens diplômés. Mais malgré tout, à ce jour on n’a jamais mis les moyens qu’il fallait pour que le niveau scolaire de la population réunionnaise rattrape celui de la métropole. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il y ait autant d’illettrisme à La Réunion.
Et au niveau économique, il y a quand même eu des avancées non ?
Ça a mis beaucoup de temps quand même…Je me souviens que pendant longtemps, le niveau d’allocations familiales versé à La Réunion était de moitié de celui de métropole. Il a fallu attendre l’arrivée de la gauche et les années qui ont suivi pour que l’on commence à voir un alignement des prestations sociales avec la métropole. Pareil pour le SMIC, qui a longtemps été 70% de celui de la métropole.
Est-ce que certains chiffres donnés par l’INSEE ont-ils été transformés ou occultés par les gouvernements successifs ?
Le seul épisode dont je me souviens est intervenu dans les années 80. Nos équipes avaient fait une enquête sur l’emploi qui disait ce qu’elle avait à dire notamment sur le chômage. Elle devait être publiée en avril et le Préfet m’avait convoqué en me demandant de surseoir la parution après le 1er mai. Il se trouve que j’avais à ce moment-là mon supérieur hiérarchique qui était en mission à La Réunion. Nous sommes allés ensemble chez le Préfet et mon supérieur a accepté de différer la publication. Mais pas de modifications de chiffres. J’en ai connues mais pas ici. L’INSEE a une déontologie forte et a toujours résisté face aux pressions.
Vous êtes resté en poste jusqu’à quelle année ?
J’ai quitté La Réunion en 1985. Je n’étais pas prêt à partir mais on m’avait menacé de me mettre un supérieur hiérarchique dans mon service à l’INSEE, chose que je ne voulais pas et j’ai accepté de partir à Rouen. Mais mon arrivée à Rouen a été un choc pour moi : Après tant d’années passées ici, et même si je suis né à Paris, je me suis attaché à La Réunion. De plus, au niveau du travail, les employés que j’avais à disposition à La Réunion étaient beaucoup plus efficaces que ceux que j’avais à Rouen : pour le même boulot à La Réunion avec deux personnes, il m’en fallait 10 à Rouen ! (rires).